NIETZSZCHE : le grand brûlé de la pensée (auteur)
![]() Nietzsche
est mort en 1900, après avoir sombré onze ans auparavant
dans la folie. Avant son effondrement mental, il était réduit
à publier ses Iivres à compte d'auteur, pratiquement inconnu,
à quelques exceptions près. Soudainement, après le
drame de Turin (1), il entrait en force dans la culture
occidentale. Depuis, il a été l'objet d'interprétations
de tous ordres, vilipendé ou glorifié.
Nietzsche
est mort en 1900, après avoir sombré onze ans auparavant
dans la folie. Avant son effondrement mental, il était réduit
à publier ses Iivres à compte d'auteur, pratiquement inconnu,
à quelques exceptions près. Soudainement, après le
drame de Turin (1), il entrait en force dans la culture
occidentale. Depuis, il a été l'objet d'interprétations
de tous ordres, vilipendé ou glorifié.
![]() Comme le souligne
Marc Crepon, dans Les Cahiers l'Herne qui lui sont consacrés,
c'est une obligation incontournable de s'expliquer avec l'œuvre de
Nietzsche. Celle-ci, en ce début de millénaire, suscite
d'innombrables commentaires, ainsi que l'avait pressenti l'auteur de Ainsi
parlait Zarathoustra, qui disait que son livre était pour tout
le monde et pour personne.
Comme le souligne
Marc Crepon, dans Les Cahiers l'Herne qui lui sont consacrés,
c'est une obligation incontournable de s'expliquer avec l'œuvre de
Nietzsche. Celle-ci, en ce début de millénaire, suscite
d'innombrables commentaires, ainsi que l'avait pressenti l'auteur de Ainsi
parlait Zarathoustra, qui disait que son livre était pour tout
le monde et pour personne.
![]() « Je suis
un champ de bataille », écrivit-il un jour. Cette définition,
empruntée par Ernst Nolte comme titre de son ouvrage sur Nietzsche,
résume une pensée qui n'a cessé de se remettre en
question, voire de se contester.
« Je suis
un champ de bataille », écrivit-il un jour. Cette définition,
empruntée par Ernst Nolte comme titre de son ouvrage sur Nietzsche,
résume une pensée qui n'a cessé de se remettre en
question, voire de se contester.
![]() Selon les moments,
parfois dans la même foulée, Nietzsche est antisémite,
philosémite, misogyne, ami des femmes, etc. Il dénonce lescientisme
de son époque, mais il en est imprégné d'une certaine
manière. Il multiplie les imprécations contre ses compatriotes
allemands, mais il est aussi un héros génial de la culture
germanique.
Selon les moments,
parfois dans la même foulée, Nietzsche est antisémite,
philosémite, misogyne, ami des femmes, etc. Il dénonce lescientisme
de son époque, mais il en est imprégné d'une certaine
manière. Il multiplie les imprécations contre ses compatriotes
allemands, mais il est aussi un héros génial de la culture
germanique.
![]() Cette effervescence,
ce gout des extrêmes jusqu'à la contradiction ont été
à l'origine des jugements passionnés sur Nietzsche. En France,
après avoir été accueilli avec enthousiasme au début
du siècle par nombre d'écrivains et d'artistes, il symbolisa
la barbarie teutonne pendant la Première Guerre mondiale, avant
d'êlre considéré comme le maître penseur du
nazisme par nombre d'intellectuels. George Bataille et quelques autres
faisant exception à la règle.
Cette effervescence,
ce gout des extrêmes jusqu'à la contradiction ont été
à l'origine des jugements passionnés sur Nietzsche. En France,
après avoir été accueilli avec enthousiasme au début
du siècle par nombre d'écrivains et d'artistes, il symbolisa
la barbarie teutonne pendant la Première Guerre mondiale, avant
d'êlre considéré comme le maître penseur du
nazisme par nombre d'intellectuels. George Bataille et quelques autres
faisant exception à la règle.
![]() Chez nous, pendant
longtemps, Nïetzsche fut l'objet de la défiance des philosophes
professionnels. Sa formation de philologue, ses outrances verbales, sa
folie alimentaient ces soupçons corporatistes. Il en était
ainsi dans une moindre mesure en Allemagne. C'est Karl Jaspers et surtout
Martin Heidegger qui l'intronisèrent en tant que philosophe.
Chez nous, pendant
longtemps, Nïetzsche fut l'objet de la défiance des philosophes
professionnels. Sa formation de philologue, ses outrances verbales, sa
folie alimentaient ces soupçons corporatistes. Il en était
ainsi dans une moindre mesure en Allemagne. C'est Karl Jaspers et surtout
Martin Heidegger qui l'intronisèrent en tant que philosophe.
![]() Au début des
années 60, la France suivit le mouvement, sous l'impulsion de Michel
Foucault, Gilles Deleuze et quelques autres. Aujourd'hui, Nietzsche occupe
une place majeure dans le Panthéon des penseurs, distançant
Marx, Freud, etc.
Au début des
années 60, la France suivit le mouvement, sous l'impulsion de Michel
Foucault, Gilles Deleuze et quelques autres. Aujourd'hui, Nietzsche occupe
une place majeure dans le Panthéon des penseurs, distançant
Marx, Freud, etc.
![]() L'œcuménisme
ambiant ne dissimule-t-il pas d'autres malentendus ? Ceux-ci furent d'abord
nourris, après l'effondrement mental de Nietzsche, par la sœur
du penseur avec laquelle il avait pratiquement rompu, qu'il jugeait bête
et méchante. Elizabeth n'hésita pas à tripatouiller
l'énorme masse de manuscrits laissés par son frère
afin de donner de lui une image selon son goût. Elle contribua plus
qu'aucune autre personne à accréditer la vision d'un Nietzsche
pangermaniste. Dans ses dernières années, elle reçut
Hitler avec ravissement.
L'œcuménisme
ambiant ne dissimule-t-il pas d'autres malentendus ? Ceux-ci furent d'abord
nourris, après l'effondrement mental de Nietzsche, par la sœur
du penseur avec laquelle il avait pratiquement rompu, qu'il jugeait bête
et méchante. Elizabeth n'hésita pas à tripatouiller
l'énorme masse de manuscrits laissés par son frère
afin de donner de lui une image selon son goût. Elle contribua plus
qu'aucune autre personne à accréditer la vision d'un Nietzsche
pangermaniste. Dans ses dernières années, elle reçut
Hitler avec ravissement.
![]() Le plus célèbre
exemple de ce détournement fut la publication de La Volonté
de puissance, reprise du titre d'une œuvre que Nietzsche
avait longtemps projeté d'écrire mais à laquelle
il avait renoncé dans les derniers mois de sa vie consciente. Elizabeth
fabriqua de toutes pièces ce livre qui n'avait jamais existé,
ainsi que le démontrèrent Colli et Montinari.
Le plus célèbre
exemple de ce détournement fut la publication de La Volonté
de puissance, reprise du titre d'une œuvre que Nietzsche
avait longtemps projeté d'écrire mais à laquelle
il avait renoncé dans les derniers mois de sa vie consciente. Elizabeth
fabriqua de toutes pièces ce livre qui n'avait jamais existé,
ainsi que le démontrèrent Colli et Montinari.
![]() Il n'est pas sûr
que les interprétations abusives appartiennent au passé.
Ainsi, les versions de gauche, démocratiques, libertaires, du penseur
pour qui la notion de force est essentielle, laissent rêveur. Et
le relativisme de ses valeurs favorise parfois le nihilisme moderne, qu'il
a pourtant traqué plus vigoureusement qu'aucun autre.
Il n'est pas sûr
que les interprétations abusives appartiennent au passé.
Ainsi, les versions de gauche, démocratiques, libertaires, du penseur
pour qui la notion de force est essentielle, laissent rêveur. Et
le relativisme de ses valeurs favorise parfois le nihilisme moderne, qu'il
a pourtant traqué plus vigoureusement qu'aucun autre.
![]() Chacun a son Nietzsche.
Cela tient à la nature de sa pensée, mais aussi à
sa personnalité, à son destin. De lourdes inhibitions contribuèrent
à en faire un homme malheureux, effroyablement solitaire. Ce fils
de pasteur, qui ne connut pratiquement pas son père et passa son
enfance auprès de sa mère et de sa sœur, tenta sans
cesse et en vain de sortir de son isolement.
Chacun a son Nietzsche.
Cela tient à la nature de sa pensée, mais aussi à
sa personnalité, à son destin. De lourdes inhibitions contribuèrent
à en faire un homme malheureux, effroyablement solitaire. Ce fils
de pasteur, qui ne connut pratiquement pas son père et passa son
enfance auprès de sa mère et de sa sœur, tenta sans
cesse et en vain de sortir de son isolement.
![]() Avide de reconnaissance,
il était parfois dans ses relations humaines d'une incroyable naïveté,
demandant aux autres ce qu'ils ne pouvaient lui offiir, les inventant
littéralement, puis ne leur pardonnant pas de l'avoir déçu.
Il en fut ainsi avec Rhode, Richard et Cosima Wagner, Paul Rée,
Lou Salomé, etc. Nietzsche brûlait ce qu'il avait adoré.
Cela fut vrai aussi sur le plan des idées. Ainsi s'acharnat-il
contre Schopenhauer qu'il avait idolâtré. Seules quelques
rares figures du passé furent à l'abri de ses sentiments,
dont Héraclite et Goethe.
Avide de reconnaissance,
il était parfois dans ses relations humaines d'une incroyable naïveté,
demandant aux autres ce qu'ils ne pouvaient lui offiir, les inventant
littéralement, puis ne leur pardonnant pas de l'avoir déçu.
Il en fut ainsi avec Rhode, Richard et Cosima Wagner, Paul Rée,
Lou Salomé, etc. Nietzsche brûlait ce qu'il avait adoré.
Cela fut vrai aussi sur le plan des idées. Ainsi s'acharnat-il
contre Schopenhauer qu'il avait idolâtré. Seules quelques
rares figures du passé furent à l'abri de ses sentiments,
dont Héraclite et Goethe.
![]() Que le tempérament,
les inhibitions, la misère de l'homme Nietzsche dont la santé
était exécrable, aient influencé sa pensée,
c'est une évidence trop souvent négligée que Giorgio
Colli (qui plus qu'aucun autre a servi son œuvre) a remarquablement
analysée. Ils sont à l'origine de son impulsivité,
de ses retournements, de son goût pour les aphorismes et de sa répugnance
à un travail théorique continu.
Que le tempérament,
les inhibitions, la misère de l'homme Nietzsche dont la santé
était exécrable, aient influencé sa pensée,
c'est une évidence trop souvent négligée que Giorgio
Colli (qui plus qu'aucun autre a servi son œuvre) a remarquablement
analysée. Ils sont à l'origine de son impulsivité,
de ses retournements, de son goût pour les aphorismes et de sa répugnance
à un travail théorique continu.
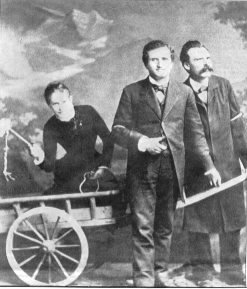
La « sainte trinité » en mai 1882 : Lou von Salomé
qui deviendra plus tard Lou Andeas-Salomé, Paul Rée et Friedrich
Nietzsche.
La mise en scène a été pensée par Nietzsche
(photo AKG)
![]() On ne peut approcher
profondément Nietzsche si l'on n'est pas conscient de sa marginailité.
Elle est absolue, différente de celle de Freud et Marx, avec qui
Nolte le compare souvent d'une manière peu convaincante. Le pessimisme
de Nietzsche, son mépris de la plèbe, de la démocratie,
a peu à voir avec l'optimisme historique de Marx.
On ne peut approcher
profondément Nietzsche si l'on n'est pas conscient de sa marginailité.
Elle est absolue, différente de celle de Freud et Marx, avec qui
Nolte le compare souvent d'une manière peu convaincante. Le pessimisme
de Nietzsche, son mépris de la plèbe, de la démocratie,
a peu à voir avec l'optimisme historique de Marx.
![]() Mais Nietzsche n'est·il
pas toujours insaisissable ? Ainsi on attitude ambiguë à l'égard
des Lumières, alliées contre le christianisme dans Humain
trop humain, stigmatisées plus tard comme fourrier de la raison
et de l'égalitarisme. Il y a aussi une caractéristique de
Nietzsche que l'on oublie trop souvent et que rappelle Giorgio Colli.
C'était un graphomane intarissable, qui écrivit en vingt
ans des dizaines de milliers de pages - ce qui a sa part dans ses apparentes
contradictions.
Mais Nietzsche n'est·il
pas toujours insaisissable ? Ainsi on attitude ambiguë à l'égard
des Lumières, alliées contre le christianisme dans Humain
trop humain, stigmatisées plus tard comme fourrier de la raison
et de l'égalitarisme. Il y a aussi une caractéristique de
Nietzsche que l'on oublie trop souvent et que rappelle Giorgio Colli.
C'était un graphomane intarissable, qui écrivit en vingt
ans des dizaines de milliers de pages - ce qui a sa part dans ses apparentes
contradictions.
![]() Il n'y a pas de vérité
en soi, pas de monde vrai. « Nietzsche ne connaît pas de
noumènes », remarque David Allison dans le dossier de
l'Herne. Mathieu Kessler, dans un numéro de la Revue
internationale de philosophie qui lui est consacré, s'en prend
à la thèse de Heidegger selon laquelle Nietzsche serait
le dernier des métaphysiciens. Il retourne son compliment à
l'auteur de L'Etre et le Temps, observe que son indépendance
à l'égard des préjugés métaphysiques
n'est pas toujours sans faille.
Il n'y a pas de vérité
en soi, pas de monde vrai. « Nietzsche ne connaît pas de
noumènes », remarque David Allison dans le dossier de
l'Herne. Mathieu Kessler, dans un numéro de la Revue
internationale de philosophie qui lui est consacré, s'en prend
à la thèse de Heidegger selon laquelle Nietzsche serait
le dernier des métaphysiciens. Il retourne son compliment à
l'auteur de L'Etre et le Temps, observe que son indépendance
à l'égard des préjugés métaphysiques
n'est pas toujours sans faille.
![]() En deçà
du désordre, des renversements de la pensée nietzschéenne,
n'y aurait-il pas aussi une profonde continuité ? Entre La Naissance
de la tragédie et les derniers livres perdurent certains thèmes
: le mythe de Dionysos, le oui à la vie, etc. Si Nietzsche répugne
à employer le mot transcendance, cette notion existe bel et bIen
dans la volonté de puissance, dans la célébration
de « l'Amor fati ». Le surhomme, ce n'est pas la brute blonde,
mais l'individu avide de connaissances, qui se dépasse sans cesse.
Nietzsche a toujours hissé l'art, la musique notamment, au-dessus
des autres activités humaines. Il fut un grand écrivain
par son style, sa vision poétique et profonde de l'énigme
de l'existence. S'il y eut un esprit libre, ce fut bien lui.
En deçà
du désordre, des renversements de la pensée nietzschéenne,
n'y aurait-il pas aussi une profonde continuité ? Entre La Naissance
de la tragédie et les derniers livres perdurent certains thèmes
: le mythe de Dionysos, le oui à la vie, etc. Si Nietzsche répugne
à employer le mot transcendance, cette notion existe bel et bIen
dans la volonté de puissance, dans la célébration
de « l'Amor fati ». Le surhomme, ce n'est pas la brute blonde,
mais l'individu avide de connaissances, qui se dépasse sans cesse.
Nietzsche a toujours hissé l'art, la musique notamment, au-dessus
des autres activités humaines. Il fut un grand écrivain
par son style, sa vision poétique et profonde de l'énigme
de l'existence. S'il y eut un esprit libre, ce fut bien lui.
![]() Cet homme solitaire,
issu du XIX' siècle, a pressenti mieux qu'aucun autre notre monde
d'aujourd'hui, au-delà du bien et du mal, a dénoncé
par avance ses pièges, ses aliénations, sa barbarie. C'est
en quoi il est notre contemporain, irremplaçable et unique.
Cet homme solitaire,
issu du XIX' siècle, a pressenti mieux qu'aucun autre notre monde
d'aujourd'hui, au-delà du bien et du mal, a dénoncé
par avance ses pièges, ses aliénations, sa barbarie. C'est
en quoi il est notre contemporain, irremplaçable et unique.
Article de Claude Jannoud paru dans LE FIGARO LITTERAIRE
Bibliographie
-
Nietzsche Le Champ de bataille d'Ernst Nolte Préface d'Edouard Husson Traduit de l'allemand par Fanny Husson Bartillat, 139 F.
-
Nietzsche « Cahiers de l'Herne » Sous la direction de Constantin Tacou
-
Nietzsche Revue internationale de philosophie présenté par Angèle Kremer-Marinetti PUF, 23,50 €.
-
Après Nietzsche de Giorgio Colli Editions de l'Eclat. 7,90 €
-
Nietzsche Cahiers posthumes - III de Giorgio Colli Editions de l'Eclat. 7,90 €.
NOTE. (1) NDLR : qui le verra sombrer dans la folie.
![]()
