Nietzsche était-il Français ?
![]() Le 25 août
1900, un philologue allemand s'éteint dans l'anonymat le plus parfait.
Son nom ? Friedrich Nietzsche. Utilisée à tort et à
travers, son œuvre a alimenté un siècle de polémique.
Loin d'être le prophète du pangermanisme que l'on s'est complu
à décrire, Nietzsche n'était-il pas plutôt
un de nos plus grands écrivains de tradition française ?
Le 25 août
1900, un philologue allemand s'éteint dans l'anonymat le plus parfait.
Son nom ? Friedrich Nietzsche. Utilisée à tort et à
travers, son œuvre a alimenté un siècle de polémique.
Loin d'être le prophète du pangermanisme que l'on s'est complu
à décrire, Nietzsche n'était-il pas plutôt
un de nos plus grands écrivains de tradition française ?
![]() « Mille neuf
cent est l'année terrible, Nietzsche meurt. Le premier de la classe
disparu, ne restent que les cancres. »
« Mille neuf
cent est l'année terrible, Nietzsche meurt. Le premier de la classe
disparu, ne restent que les cancres. »
Ce propos de Jean Cocteau, qui oserait le tenir aujourd'hui ? L'affaire est
entendue : la philosophie n'a plus de sens; Dieu revient, paraît-il ;
les idéologies sont derrière nous; l'époque s'exalte
au mieux dans sa course au divertissement. Deux guerres mondiales et des
millions de morts n'ont-ils pas eu raison de l'orgueil qu'un homme peut
avoir à penser ? A réfléchir dans la solitude, au sens
qu'il importe d'essayer de donner à soi-même et au monde ?
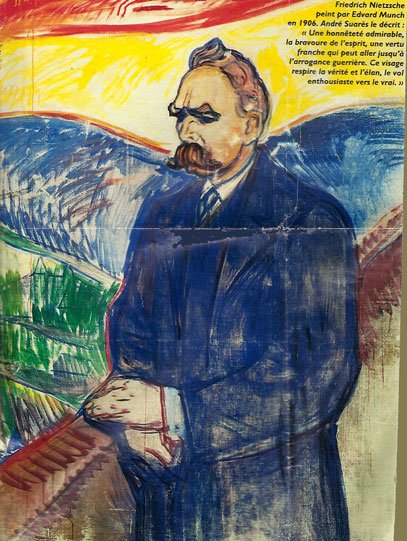 Faites
silence. Passez outre. Ouvrez Nietzsche : le Crépuscule des
idoles, par exemple, ou n'importe lequel de ses livres écrits
à la hâte dans le seul but d'annoncer une bonne nouvelle
dont on commence seulement à comprendre la portée, au terme
d'un siècle où les cancres ont certes tous triomphé.
Qu'y voit-on ? Un mouvement insurrectionnel qui ne vise à rien
moins qu'à rétablir l'homme dans sa vraie patrie : cette
âme et ce corps illimités qu'il a eu la folie de déserter
au profit d'un monde effroyablement rétréci, où il
risque à présent de finir emmuré. On vous avait pourtant
mis en garde. Nietzsche ? Un ancêtre du fascisme, annexé
par les nazis, antisémite en diable, pangermaniste dans l'âme.
Un pervers ? Un malade !
Faites
silence. Passez outre. Ouvrez Nietzsche : le Crépuscule des
idoles, par exemple, ou n'importe lequel de ses livres écrits
à la hâte dans le seul but d'annoncer une bonne nouvelle
dont on commence seulement à comprendre la portée, au terme
d'un siècle où les cancres ont certes tous triomphé.
Qu'y voit-on ? Un mouvement insurrectionnel qui ne vise à rien
moins qu'à rétablir l'homme dans sa vraie patrie : cette
âme et ce corps illimités qu'il a eu la folie de déserter
au profit d'un monde effroyablement rétréci, où il
risque à présent de finir emmuré. On vous avait pourtant
mis en garde. Nietzsche ? Un ancêtre du fascisme, annexé
par les nazis, antisémite en diable, pangermaniste dans l'âme.
Un pervers ? Un malade !
Et dès les premières pages, vous sentez qu'on vous avait
menti :
![]() Nietzsche est plus
actuel que jamais. Intempestif, eût-il écrit. A mille
lieues de sa caricature. Celui qui signait Dionysos contre le crucifié
est tout simplement l'un des plus grands écrivains français.
Seronsnous les derniers à l'admettre, malgré le culte
que lui ont rendu Gide et Suarès, Char et Bataille, ou, plus près
de nous, Philippe Sollers, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Onfray
et Alexis Philonenko ?
Nietzsche est plus
actuel que jamais. Intempestif, eût-il écrit. A mille
lieues de sa caricature. Celui qui signait Dionysos contre le crucifié
est tout simplement l'un des plus grands écrivains français.
Seronsnous les derniers à l'admettre, malgré le culte
que lui ont rendu Gide et Suarès, Char et Bataille, ou, plus près
de nous, Philippe Sollers, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Onfray
et Alexis Philonenko ?
![]() Issu d'une vieille
famille polonaise. Nietzsche laisse une œuvre où l'on peut
voir en vérité la plus sévère dénonciation
de la culture allemande de son temps. « Qu'on lise les livres
allemands, on y a complètement oublié qu'il faut apprendre
à penser, comme on apprend à danser. » Dès
l'époque où il est étudiant à Bohn et à
Leipzig (18641869), ce fils de pasteur n'hésite pas à
dénoncer ce qu'il appelle la « culture des philistins
» (note), rejetant, entre autres, la philologie
germanique léguée par les frères Grimm et la bureaucratie
guerrière dont l'Etat prussien promet la suprématie.
Issu d'une vieille
famille polonaise. Nietzsche laisse une œuvre où l'on peut
voir en vérité la plus sévère dénonciation
de la culture allemande de son temps. « Qu'on lise les livres
allemands, on y a complètement oublié qu'il faut apprendre
à penser, comme on apprend à danser. » Dès
l'époque où il est étudiant à Bohn et à
Leipzig (18641869), ce fils de pasteur n'hésite pas à
dénoncer ce qu'il appelle la « culture des philistins
» (note), rejetant, entre autres, la philologie
germanique léguée par les frères Grimm et la bureaucratie
guerrière dont l'Etat prussien promet la suprématie.
![]() Il admire plus que
tout les moralistes et les auteurs du XVIIIe siècle
français : il travaille à réformer son style sur
l'exemple de celui de La Rochefoucauld, Pascal, Chamfort et Laclos. C'est
d'eux, et d'eux seuls, qu'il prend ce tour si français de la maxime
et de l'aphorisme, voire du conte et de l'apologie, faisant, de la sorte,
exploser la tradition allemande du système, illustrée par
Kant, Fichte et Hegel. Il s'explique dans Par-delà le bien et
le mal : « Aujourd'hui encore, la France est le siège
de la civilisation européenne la plus spirituelle et la plus raffinée,
et la grande école du goût. » Ce qu'il reproche
à ses compatriotes d'alors ? « Tantôt la bêtise
antifrançaise, tantôt la bêtise antisémite,
antipolonaise, ou romantico-chrétienne ou wagnérienne, ou
teutonique ou prussienne. » Avec en contrepoint son amour pour
ses frères d'élection, Stendhal. « sec, clair, sans
illusions », et Voltaire, auquel il dédie Humain, trop
humain.
Il admire plus que
tout les moralistes et les auteurs du XVIIIe siècle
français : il travaille à réformer son style sur
l'exemple de celui de La Rochefoucauld, Pascal, Chamfort et Laclos. C'est
d'eux, et d'eux seuls, qu'il prend ce tour si français de la maxime
et de l'aphorisme, voire du conte et de l'apologie, faisant, de la sorte,
exploser la tradition allemande du système, illustrée par
Kant, Fichte et Hegel. Il s'explique dans Par-delà le bien et
le mal : « Aujourd'hui encore, la France est le siège
de la civilisation européenne la plus spirituelle et la plus raffinée,
et la grande école du goût. » Ce qu'il reproche
à ses compatriotes d'alors ? « Tantôt la bêtise
antifrançaise, tantôt la bêtise antisémite,
antipolonaise, ou romantico-chrétienne ou wagnérienne, ou
teutonique ou prussienne. » Avec en contrepoint son amour pour
ses frères d'élection, Stendhal. « sec, clair, sans
illusions », et Voltaire, auquel il dédie Humain, trop
humain.
"Profond par superficialité"
![]() Vite écœuré
par « l'art allemand! (...) la bière allemande ! »,
il renonce à l'âge de 25 ans à la nationalité
prussienne et sera déclaré apatride jusqu'à son décès.
Il décide de passer le reste de sa vie hors de ses frontières
natales, où il ne reviendra, contraint et forcé, que pour
se faire soigner par sa sœur. Il vit d'abord en Suisse, où
il enseigne la philologie à Bâle de 1869 à 1878, puis
en France et en Italie, de 1879 à 1889. Son départ pour
Nice correspond à un double besoin : celui de recevoir la lumière
méditerranéenne, comme celui de répudier la forêt
et les brumes germaniques.
Vite écœuré
par « l'art allemand! (...) la bière allemande ! »,
il renonce à l'âge de 25 ans à la nationalité
prussienne et sera déclaré apatride jusqu'à son décès.
Il décide de passer le reste de sa vie hors de ses frontières
natales, où il ne reviendra, contraint et forcé, que pour
se faire soigner par sa sœur. Il vit d'abord en Suisse, où
il enseigne la philologie à Bâle de 1869 à 1878, puis
en France et en Italie, de 1879 à 1889. Son départ pour
Nice correspond à un double besoin : celui de recevoir la lumière
méditerranéenne, comme celui de répudier la forêt
et les brumes germaniques.
![]() Souffrant, sans amis
ni ressources, il cherche à calmer ses maux de tête par des
promenades quotidiennes dans l'arrière-pays. Et lui qui rêve
de la Grèce dont il n'atteindra jamais les rivages, il trouve dans
la France comme un reflet de l'esprit attique, soit ce vœu, mais
aussi ce serment, d'un art de vivre, au sens propre de l'expression, où
l'on peut s'autoriser d'être « profond par superficialité
».
Souffrant, sans amis
ni ressources, il cherche à calmer ses maux de tête par des
promenades quotidiennes dans l'arrière-pays. Et lui qui rêve
de la Grèce dont il n'atteindra jamais les rivages, il trouve dans
la France comme un reflet de l'esprit attique, soit ce vœu, mais
aussi ce serment, d'un art de vivre, au sens propre de l'expression, où
l'on peut s'autoriser d'être « profond par superficialité
».
![]() Pianiste virtuose
et compositeur à ses heures, mais d'une inspiration convenue, Nietzsche
pousse enfin son amour de la France jusqu'à oser opposer Wagner
à Bizet, « le dernier génie qui ait su découvrir
une beauté et une séduction nouvelles ». Le fond
de l'histoire est sans doute la passion inavouée de Nietzsche pour
la femme de Wagner, Cosima. comme sa jalousie devant les ressources d'un
génie musical dont l'accès lui fut toujours refusé.
Il n'empêche ! Il reproche à Wagner son moralisme. son sens
du drame, son absence de gaieté (Heiterkeit) et d'avoir donné
dans Parsifal un héros qu'il traite sans ambages de «
pur abruti ».
Pianiste virtuose
et compositeur à ses heures, mais d'une inspiration convenue, Nietzsche
pousse enfin son amour de la France jusqu'à oser opposer Wagner
à Bizet, « le dernier génie qui ait su découvrir
une beauté et une séduction nouvelles ». Le fond
de l'histoire est sans doute la passion inavouée de Nietzsche pour
la femme de Wagner, Cosima. comme sa jalousie devant les ressources d'un
génie musical dont l'accès lui fut toujours refusé.
Il n'empêche ! Il reproche à Wagner son moralisme. son sens
du drame, son absence de gaieté (Heiterkeit) et d'avoir donné
dans Parsifal un héros qu'il traite sans ambages de «
pur abruti ».
![]() La philosophie de
Nietzsche ? Plus que dans des réponses qui dispenseraient de voir
le mouvement profondément contradictoire qui la traverse, on peut
sans doute la ramener à une question qui n'a cessé de le
hanter : « L'homme peut-il s'ennoblir ? » Question
que posaient déjà au XIIe siècle Bemard de Clairvaux,
puis Maître Eckhart et les mystiques rhénans à sa
suite. S'ennoblir, oui, mais comment ? Au choix, et tout ensemble, par
l'art. la danse, la musique, la création de l'homme par lui-même.
de tout ce qui le replace à la hauteur de sa vraie destinée.
Les extrémistes ont sans doute utilisé Nietzsche à
tort et à travers. Il eût été préférable
qu'ils le lisent. Un siècle après sa mort, il n'est
pas trop tôt pour commencer.
La philosophie de
Nietzsche ? Plus que dans des réponses qui dispenseraient de voir
le mouvement profondément contradictoire qui la traverse, on peut
sans doute la ramener à une question qui n'a cessé de le
hanter : « L'homme peut-il s'ennoblir ? » Question
que posaient déjà au XIIe siècle Bemard de Clairvaux,
puis Maître Eckhart et les mystiques rhénans à sa
suite. S'ennoblir, oui, mais comment ? Au choix, et tout ensemble, par
l'art. la danse, la musique, la création de l'homme par lui-même.
de tout ce qui le replace à la hauteur de sa vraie destinée.
Les extrémistes ont sans doute utilisé Nietzsche à
tort et à travers. Il eût été préférable
qu'ils le lisent. Un siècle après sa mort, il n'est
pas trop tôt pour commencer.
*** Article de Stéphane Barsacq paru dans Le Figaro magazine en août 2000 ***
Note. « culture de philistins »
philistin (mot qui vient de l'allemand) : Bourgeois, hostile à
l'esprit, fermé aux lettres et aux arts.![]()
Pour aller plus loin...
-
Alexis Philonenko, Nietzsche, le rire et le tragique, Le Livre de poche, 1995.
-
Martin Heidegger, Nietzsche. Gallimard, 1971.
-
Paul Valadier, Nietzsche et la critique du christianisme. Les Editions du Cerf. 1974.
-
Matthieu Kessler, Nietzsche ou le dépassement esthétique de la métaphysique. PUF. 1999.
-
Didier Raymond, Nietzsche ou la grande santé, L'Harmattan, 1999.
-
Jean-Pierre Faye, le vrai Nietzsche : guerre à la guerre, Hermann, 1998.
-
Philippe Sollers, La Guerre du goût, Folio, 1996.
