Nietzsche, sa syphilis et sa mélancolie
![]() Ce que Nietzsche
s'efforçait de garder malgré ses malaises, c'était
la santé de son esprit. Il souffrait dans son corps mais cela ne
lui empêchait pas de penser et d'avoir l'esprit libre ; il se préoccupait
surtout de son état d'esprit... et quand il écrit Le
Gai Savoir, il se sent guéri. Donc, ceux qui parlent d'un Nietzsche
empreint d'une folie avant sa mort oublient de dire qu'il fut d'abord
un philosophe et un psychologue génial !
Ce que Nietzsche
s'efforçait de garder malgré ses malaises, c'était
la santé de son esprit. Il souffrait dans son corps mais cela ne
lui empêchait pas de penser et d'avoir l'esprit libre ; il se préoccupait
surtout de son état d'esprit... et quand il écrit Le
Gai Savoir, il se sent guéri. Donc, ceux qui parlent d'un Nietzsche
empreint d'une folie avant sa mort oublient de dire qu'il fut d'abord
un philosophe et un psychologue génial !
I. Gènes, génie et infirmités
 Cela n'est pas évident
mais quand l'on se demande d'où vient le génie, on pense
que certaines infirmités confèrent une sensibilité
plus aigüe et que, si le philosophe Epictète était
né avec une infirmité, c'était peut-être la
raison de son génie. Nietzsche prétendit que la
souffrance est utile au génie.
Cela n'est pas évident
mais quand l'on se demande d'où vient le génie, on pense
que certaines infirmités confèrent une sensibilité
plus aigüe et que, si le philosophe Epictète était
né avec une infirmité, c'était peut-être la
raison de son génie. Nietzsche prétendit que la
souffrance est utile au génie.
 Voilà de longs mois que
la recherche psychiatrique creuse la vieille idée d'un rapport
entre les maladies mentales et le génie. L'idée est vieille,
dit-on, parce qu'on en retrouve l'écho chez Aristote : «Pourquoi
les hommes éminents en philosophie, en poésie ou dans les
arts sont-ils mélancoliques ?» demandait notre philosophe
au IVe siècle avant notre ère, déjà.
Si l'on se penche sur le passé, le nombre de grands neurasthéniques,
mélancoliques, maniaco-dépressifs et autres est évidemment
impressionnant : de Schumann à Nietzsche, de Shelley à Van
Gogh en passant par Gérard de Nerval, la liste est longue. Les
psychiatres, rapporte le Dr Kay Redfield Jamison, ont relevé de
dix à trente fois plus de dépressions parmi les artistes
que parmi la population moyenne. On a donc cherché, comme c'est
rituel, un "gène de la manie dépressive", on a
cru l'avoir trouvé, mais c'était une vue simpliste, une
conclusion trop hâtive !
Voilà de longs mois que
la recherche psychiatrique creuse la vieille idée d'un rapport
entre les maladies mentales et le génie. L'idée est vieille,
dit-on, parce qu'on en retrouve l'écho chez Aristote : «Pourquoi
les hommes éminents en philosophie, en poésie ou dans les
arts sont-ils mélancoliques ?» demandait notre philosophe
au IVe siècle avant notre ère, déjà.
Si l'on se penche sur le passé, le nombre de grands neurasthéniques,
mélancoliques, maniaco-dépressifs et autres est évidemment
impressionnant : de Schumann à Nietzsche, de Shelley à Van
Gogh en passant par Gérard de Nerval, la liste est longue. Les
psychiatres, rapporte le Dr Kay Redfield Jamison, ont relevé de
dix à trente fois plus de dépressions parmi les artistes
que parmi la population moyenne. On a donc cherché, comme c'est
rituel, un "gène de la manie dépressive", on a
cru l'avoir trouvé, mais c'était une vue simpliste, une
conclusion trop hâtive !
 D'un point de vue historique,
il convient de se méfier des conclusions hâtives, car bien
des artistes du passé souffrirent de maladies qu'à l'époque
on ne pouvait soigner et qui affectèrent leurs humeurs ou leur
philosophie : Schubert, comme G. de Nerval ou Géricault, mourut
de syphilis, Beethoven était sourd, Chopin était tuberculeux,
etc. Il est bien difficile d'être souriant et égal d'humeur
quand on se sait condamné à une fin précoce ou à
une infirmité grave à vie.
D'un point de vue historique,
il convient de se méfier des conclusions hâtives, car bien
des artistes du passé souffrirent de maladies qu'à l'époque
on ne pouvait soigner et qui affectèrent leurs humeurs ou leur
philosophie : Schubert, comme G. de Nerval ou Géricault, mourut
de syphilis, Beethoven était sourd, Chopin était tuberculeux,
etc. Il est bien difficile d'être souriant et égal d'humeur
quand on se sait condamné à une fin précoce ou à
une infirmité grave à vie.
 C'est là l'intérêt
de l'épistémologie, car on s'avise qu'en ne considérant
que les artistes et génies, on s'expose à des travers d'interprétation
déjà bien connus des statisticiens prudents. Les généralités
sur la mélancolie des artistes et la recherche du gène virtuel
responsable méritent donc d'être abordés avec un peu
plus de sérieux. (note)
C'est là l'intérêt
de l'épistémologie, car on s'avise qu'en ne considérant
que les artistes et génies, on s'expose à des travers d'interprétation
déjà bien connus des statisticiens prudents. Les généralités
sur la mélancolie des artistes et la recherche du gène virtuel
responsable méritent donc d'être abordés avec un peu
plus de sérieux. (note)
 Frédéric Nietzsche,
parce qu'il fut célèbre, sa folie le fut aussi ! Mais alors
que de fous anonymes... Un mystère plane encore sur sa maladie
et les circonstances de sa mort. Est-ce la folie qui l'a emporté
? D'autres prétendent que ce serait la syphilis...
Frédéric Nietzsche,
parce qu'il fut célèbre, sa folie le fut aussi ! Mais alors
que de fous anonymes... Un mystère plane encore sur sa maladie
et les circonstances de sa mort. Est-ce la folie qui l'a emporté
? D'autres prétendent que ce serait la syphilis...  Ou
bien y-a-t-il aussi un peu de comédie chez ce sacré farceur
qui se retranche dans le mutisme pendant 10 ans ? Dernièrement,
des livres sur la question de la folie du philosophe Nietzsche ont fait
l'objet d'études psychologiques et de recherches cliniques des
symptômes de sa maladie.
Ou
bien y-a-t-il aussi un peu de comédie chez ce sacré farceur
qui se retranche dans le mutisme pendant 10 ans ? Dernièrement,
des livres sur la question de la folie du philosophe Nietzsche ont fait
l'objet d'études psychologiques et de recherches cliniques des
symptômes de sa maladie.
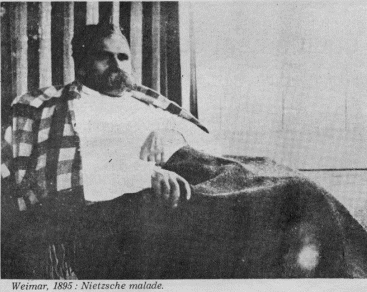 LA
MALADIE, CRITÈRE DES VALEURS CHEZ NIETZSCHE
LA
MALADIE, CRITÈRE DES VALEURS CHEZ NIETZSCHE
Prémices d'une psychanalyse des affects, d'Ariane Bilheran,
Ouverture Philosophique, Ed. L'harmattan, mai 2005
(112 pages - Prix éditeur : 11,5 € / 75 FF)
 Ariane Biheran présente
ainsi son étude sur sa maladie psychologique :
Ariane Biheran présente
ainsi son étude sur sa maladie psychologique :
« Nietzsche n'a cessé d'établir des diagnostics : diagnostics d'individus et de civilisations jugés sains ou malades. Se pose alors la question de la définition de la maladie dans son œuvre. Si l'une des ambitions nietzschéennes réside dans la “transvaluation de toutes les valeurs", quel rôle la notion de maladie joue-t-elle au sein de cet impératif ? En quoi certaines valeurs sont-elles malades et affectent-elles les individus ou civilisations qui les érigent et revendiquent ? Par cette étude, l'auteur entend promouvoir le dialogue entre philosophie et psychanalyse.»
II. Nietzsche et la mélancolie
 Tel est le titre de la thèse de
Philippe Cadiou écrite en réponse au livre de Jacques ROGER,
Le Syndrome de Nietzsche.
Tel est le titre de la thèse de
Philippe Cadiou écrite en réponse au livre de Jacques ROGER,
Le Syndrome de Nietzsche.
 Dans ce livre, Jacques Roger
relit la vie et les concepts de Nietzsche (sans pour autant dénigrer
ses avancées philosophiques) à la lumière d'une nouvelle
théorie sur la maladie de Nietzsche : ni comédie, ni syphilis,
mais maniaco-dépression dont le philosophe souffrait depuis l'adolescence
(liée à une impossibilité de remplacer un père
mort trop tôt). Est-ce un parti-pris qui ne tient pas assez compte
de l'empire de la syphilis qui est encore mal connue et mal traitée
au XIXe siècle, bien avant la mise au point d'antibiotiques
?
Dans ce livre, Jacques Roger
relit la vie et les concepts de Nietzsche (sans pour autant dénigrer
ses avancées philosophiques) à la lumière d'une nouvelle
théorie sur la maladie de Nietzsche : ni comédie, ni syphilis,
mais maniaco-dépression dont le philosophe souffrait depuis l'adolescence
(liée à une impossibilité de remplacer un père
mort trop tôt). Est-ce un parti-pris qui ne tient pas assez compte
de l'empire de la syphilis qui est encore mal connue et mal traitée
au XIXe siècle, bien avant la mise au point d'antibiotiques
?
 Philippe Cadiou a emprunté
à ce livre toute la première partie de ses recherches et
fait une étude rigoureuse de la sémiologie clinique des
symptômes de sa maladie. Il conclut que l’effondrement de
1889 – qui aboutit à la mort intellectuelle du philosophe
– est l’aboutissement d’une psychose maniaco-dépressive
qui remonte aux sources de l’adolescence et qui a accompagné
toute sa vie l’œuvre et la pensée de Nietzsche. Jusqu’alors
le diagnostic de syphilis cérébrale permettait de considérer
que la « folie » n’avait jamais « contaminé
» son œuvre jusqu’au fameux épisode de Turin où
le philosophe se pend au cou d’un cheval battu et se retire définitivement
dans le monde opaque du mutisme. Cette fois, l’hypothèse
de la Syphilis est presque définitivement invalidée, sinon
sérieusement ébranlée. (Nietzsche
et la mélancolie, Ed. Odile Jacob,
22€ Amazon).
Philippe Cadiou a emprunté
à ce livre toute la première partie de ses recherches et
fait une étude rigoureuse de la sémiologie clinique des
symptômes de sa maladie. Il conclut que l’effondrement de
1889 – qui aboutit à la mort intellectuelle du philosophe
– est l’aboutissement d’une psychose maniaco-dépressive
qui remonte aux sources de l’adolescence et qui a accompagné
toute sa vie l’œuvre et la pensée de Nietzsche. Jusqu’alors
le diagnostic de syphilis cérébrale permettait de considérer
que la « folie » n’avait jamais « contaminé
» son œuvre jusqu’au fameux épisode de Turin où
le philosophe se pend au cou d’un cheval battu et se retire définitivement
dans le monde opaque du mutisme. Cette fois, l’hypothèse
de la Syphilis est presque définitivement invalidée, sinon
sérieusement ébranlée. (Nietzsche
et la mélancolie, Ed. Odile Jacob,
22€ Amazon).
Nietzsche était-il un mélancolique
dépressif ?
Nietzsche
en proie à la folie ? Il semblerait que le livre "définitif" sur le sujet soit
:
Il semblerait que le livre "définitif" sur le sujet soit
:
L'effondrement
de Nietzsche (Poche), de Podach
Note
Ce genre de recherches connaît un grand retentisement et deux livres
parus aux Etats-Unis en témoignent : Touched With Fire : Manic
Depressive Illness and Artistic Temperament, du Dr Jamison, déjà
citée, et The Price of Greatness, du Dr Ludwig. Mais ils
nous laissent sceptiques. Si l'on reprend les taux cités par Ludwig,
on se demandera pourquoi l'on trouve si peu d'alcooliques, 3 %, donc parmi
les physiciens. Manqueraient-ils donc de génie ? Il s'en faut.
Ne serait-ce pas plutôt parce qu'ils sont mariés et sont
donc bien moins exposés aux intermittences du cœur et à
l'intempérance que les artistes ?
Et ces derniers ? Existe-t-il donc un gène du comédien,
du poète et du peintre ? Ou n'est-ce pas plutôt que leur
sensibilité aigüe, fibre essentielle de leur métier
les rend plus vulnérables que les fonctionnaires aux cahots de
l'humeur ? Si l'on trouve tant de dépressions chez eux, ne serait-ce
pas parce que leur gagne-pain dépend de leur talent, qui est chose
variable, et de leur succès ? Un peintre qui ne vend rien, comme
Van Gogh, n'est guère disposé à prendre la vie du
bon côté.
Puis il faut se demander si, après tout, les génies se recrutant
comme le reste dans le civil, ils ne seraient pas exposés aux mêmes
maladies. Car enfin, les quelque 100 000 malades mentaux dénombrés
chaque année en hospitalisation complète et les quelque
25 millions de journées d'hospitalisation annuelles pour maladie
mentale ne sont peut-être pas le fait exclusif des génies
ou des sensibilités exacerbées. Et les quelque 10 000 suicides
annuels (environ un par heure, sans compter les tentatives) ne sont pas
non plus, qu'on sache, le fait exclusif d'artistes ni de génies.
(Sciences & Vie N° 916) ![]()

