Nietzsche et la mélancolie, par Philippe Cadiou
![]() Dernièrement,
un livre sur la question de la folie du philosophe Nietzsche [1]
a fait une étude rigoureuse de la sémiologie clinique des symptômes de
sa maladie. Il conclut que l’effondrement de 1889 – qui aboutit à la mort
intellectuelle du philosophe – est l’aboutissement d’une psychose maniaco-dépressive
qui remonte aux sources de l’adolescence et qui a accompagné toute sa
vie l’œuvre et la pensée de Nietzsche. Jusqu’alors le diagnostic de syphilis
cérébrale permettait de considérer que la « folie » n’avait
jamais « contaminé » son œuvre jusqu’au fameux épisode de Turin
où le philosophe se pend au cou d’un cheval battu et se retire définitivement
dans le monde opaque du mutisme. Cette fois l’hypothèse de la Syphilis,
est presque définitivement invalidée, sinon sérieusement ébranlée. L’auteur
montre qu’elle ne saurait nous faire oublier de toute évidence les périodes
d’alternance des phases maniaques et des phases dépressives qui ont rythmé
de leur périodicité la vie et l’activité créatrice du penseur. Il faut
à présent compter avec l’idée que Nietzsche a eu à faire face toute son
existence au phénomène de sa propre psychose – une maladie bipolaire de
l’humeur. Ce qui n’invalide pas le contenu de ses découvertes philosophiques
mais nous rapproche plus que jamais de la sensibilité aiguë et énigmatique
de son génie. Jusqu’à présent les biographies de Nietzsche étaient incapables
de comprendre ses bizarreries. Elles les écartaient souvent au nom du
sérieux de la pensée. La folie de Nietzsche reste toujours dans les cercles
qui s’autorisent de son nom - un tabou. On y trouve toutes
sortes de théories du « pathos sacré » qui entretiennent
une mystique romantique du génie et dénigrent les avancées dans ce domaine
[2].
Dernièrement,
un livre sur la question de la folie du philosophe Nietzsche [1]
a fait une étude rigoureuse de la sémiologie clinique des symptômes de
sa maladie. Il conclut que l’effondrement de 1889 – qui aboutit à la mort
intellectuelle du philosophe – est l’aboutissement d’une psychose maniaco-dépressive
qui remonte aux sources de l’adolescence et qui a accompagné toute sa
vie l’œuvre et la pensée de Nietzsche. Jusqu’alors le diagnostic de syphilis
cérébrale permettait de considérer que la « folie » n’avait
jamais « contaminé » son œuvre jusqu’au fameux épisode de Turin
où le philosophe se pend au cou d’un cheval battu et se retire définitivement
dans le monde opaque du mutisme. Cette fois l’hypothèse de la Syphilis,
est presque définitivement invalidée, sinon sérieusement ébranlée. L’auteur
montre qu’elle ne saurait nous faire oublier de toute évidence les périodes
d’alternance des phases maniaques et des phases dépressives qui ont rythmé
de leur périodicité la vie et l’activité créatrice du penseur. Il faut
à présent compter avec l’idée que Nietzsche a eu à faire face toute son
existence au phénomène de sa propre psychose – une maladie bipolaire de
l’humeur. Ce qui n’invalide pas le contenu de ses découvertes philosophiques
mais nous rapproche plus que jamais de la sensibilité aiguë et énigmatique
de son génie. Jusqu’à présent les biographies de Nietzsche étaient incapables
de comprendre ses bizarreries. Elles les écartaient souvent au nom du
sérieux de la pensée. La folie de Nietzsche reste toujours dans les cercles
qui s’autorisent de son nom - un tabou. On y trouve toutes
sortes de théories du « pathos sacré » qui entretiennent
une mystique romantique du génie et dénigrent les avancées dans ce domaine
[2].
![]() "L’effondrement
dépressif de 1889 fait suite en réalité à une très longue histoire. Nietzsche
a lui-même longuement étudié sa souffrance avec une lucidité très précise
au cours de ce qu’il a appelé sa « longue maladie ». La vie
de Nietzsche est un combat permanent contre la maladie mais aussi
avec la maladie qui alternait à la fois « Humeur noire »
et « agitation véhémente ». La maladie de Nietzsche,
s’il faut lui donner un nom, s’apparente aux signes de la mélancolie.
Elle est à la fois la source de la créativité de son œuvre et source de
sa destruction. Les échecs professionnels, les hallucinations visuelles
dont le philosophe était coutumier, les excitations maniaques (que Nietzsche
appellera « dionysiaques ») qui provoquaient chez lui une fuite
des idées et des phénomènes de dépersonnalisation en rendant incontrôlables
les émotions, la rapidité et la violence des modifications de l’humeur,
la vie errante du philosophe et sa solitude forcenée (qui est celle de
son personnage central Zarathoustra), nous permettent de déceler chez
ce sujet une forme de psychose. Il s’agirait d’une forme d’hypomanie relativement
modérée qui laissera intacte la conscience du philosophe ainsi que son
activité critique jusqu’à leur aggravation dans la détérioration de 1889.
Priorité doit être donnée à la pensée de l’auteur sur sa vie. Deleuze
affirme que la maladie n’a jamais été un thème d’inspiration chez Nietzsche.
Cependant c’est à partir de sa position
dans la maladie qu’il affronte toutes les grandes questions théoriques
de son œuvre[3]. On peut donc
montrer comment les concepts centraux de la philosophie nietzschéenne
(la volonté de puissance et l’éternel retour par exemple) se construisent
contre sa propre mélancolie, le nihilisme, mais sur le mode de la mélancolie.
Si la maladie n’est pas source d’inspiration, elle est le noyau central
autour duquel gravite l’intelligence de Nietzsche et les solutions que
sa pensée élabore trouvent en elle ses racines. Notre hypothèse est la
suivante : Nietzsche va construire Dionysos sur le mode d’une métaphore
délirante comme substitution à la métaphore paternelle manquante. La structure
bipolaire de l’humeur maniaco-dépressive va imprimer sa marque sur l’ensemble
des créations du philosophe. L’inconscient va poser sa marque sur la logique
des concepts et nous pouvons voir y apparaître en transparence la structure
de la psychose."
"L’effondrement
dépressif de 1889 fait suite en réalité à une très longue histoire. Nietzsche
a lui-même longuement étudié sa souffrance avec une lucidité très précise
au cours de ce qu’il a appelé sa « longue maladie ». La vie
de Nietzsche est un combat permanent contre la maladie mais aussi
avec la maladie qui alternait à la fois « Humeur noire »
et « agitation véhémente ». La maladie de Nietzsche,
s’il faut lui donner un nom, s’apparente aux signes de la mélancolie.
Elle est à la fois la source de la créativité de son œuvre et source de
sa destruction. Les échecs professionnels, les hallucinations visuelles
dont le philosophe était coutumier, les excitations maniaques (que Nietzsche
appellera « dionysiaques ») qui provoquaient chez lui une fuite
des idées et des phénomènes de dépersonnalisation en rendant incontrôlables
les émotions, la rapidité et la violence des modifications de l’humeur,
la vie errante du philosophe et sa solitude forcenée (qui est celle de
son personnage central Zarathoustra), nous permettent de déceler chez
ce sujet une forme de psychose. Il s’agirait d’une forme d’hypomanie relativement
modérée qui laissera intacte la conscience du philosophe ainsi que son
activité critique jusqu’à leur aggravation dans la détérioration de 1889.
Priorité doit être donnée à la pensée de l’auteur sur sa vie. Deleuze
affirme que la maladie n’a jamais été un thème d’inspiration chez Nietzsche.
Cependant c’est à partir de sa position
dans la maladie qu’il affronte toutes les grandes questions théoriques
de son œuvre[3]. On peut donc
montrer comment les concepts centraux de la philosophie nietzschéenne
(la volonté de puissance et l’éternel retour par exemple) se construisent
contre sa propre mélancolie, le nihilisme, mais sur le mode de la mélancolie.
Si la maladie n’est pas source d’inspiration, elle est le noyau central
autour duquel gravite l’intelligence de Nietzsche et les solutions que
sa pensée élabore trouvent en elle ses racines. Notre hypothèse est la
suivante : Nietzsche va construire Dionysos sur le mode d’une métaphore
délirante comme substitution à la métaphore paternelle manquante. La structure
bipolaire de l’humeur maniaco-dépressive va imprimer sa marque sur l’ensemble
des créations du philosophe. L’inconscient va poser sa marque sur la logique
des concepts et nous pouvons voir y apparaître en transparence la structure
de la psychose."
Sur le diagnostic de la Syphilis
![]() "Les symptômes
de l’effondrement mental de Nietzsche coïncident mal avec le tableau clinique
de la syphilis. La psychose maniaco-dépressive ne sera « inventée »
qu’en 1899 par le psychiatre Kraepelin. Avant cette date il semble que
l’on ait beaucoup fait appel au diagnostic de la syphilis pour penser
la détérioration mentale. Le psychiatre Binswanger qui a examiné Nietzsche
à Iéna en 1889 n’était lui-même pas sûr de son état. Lorsque, par exemple,
survient le troisième stade de la syphilis, la paralysie générale devient
très rapide. Pour Nietzsche cette paralysie n’a pas été très brutale puisque
dans les premières années de son quasi-mutisme, le philosophe continue
de jouer du piano, par exemple les sonates de Beethoven, avec une dextérité
assez remarquable d’après les témoins. Un autre argument va à l’encontre
de la thèse de la syphilis : Nietzsche affirme à Iéna qu’il a contracté
deux fois le chancre syphilitique (alors qu’on ne peut le contracter qu’une
seule fois)." Cet élément serait la preuve que Nietzsche n’était
pas atteint de la syphilis pour Jacques Roger.
"Les symptômes
de l’effondrement mental de Nietzsche coïncident mal avec le tableau clinique
de la syphilis. La psychose maniaco-dépressive ne sera « inventée »
qu’en 1899 par le psychiatre Kraepelin. Avant cette date il semble que
l’on ait beaucoup fait appel au diagnostic de la syphilis pour penser
la détérioration mentale. Le psychiatre Binswanger qui a examiné Nietzsche
à Iéna en 1889 n’était lui-même pas sûr de son état. Lorsque, par exemple,
survient le troisième stade de la syphilis, la paralysie générale devient
très rapide. Pour Nietzsche cette paralysie n’a pas été très brutale puisque
dans les premières années de son quasi-mutisme, le philosophe continue
de jouer du piano, par exemple les sonates de Beethoven, avec une dextérité
assez remarquable d’après les témoins. Un autre argument va à l’encontre
de la thèse de la syphilis : Nietzsche affirme à Iéna qu’il a contracté
deux fois le chancre syphilitique (alors qu’on ne peut le contracter qu’une
seule fois)." Cet élément serait la preuve que Nietzsche n’était
pas atteint de la syphilis pour Jacques Roger.
Le philosophe Alain de Bottom dans son ouvrage Les consolations de la philosophie reprend la célèbre théorie à son compte : « Il souffrait depuis sa jeunesse de toutes sortes de maux – migraines, indigestions, vomissements, vertiges, quasi-cécité, insomnie – dont certains devaient être les symptômes de la syphilis qu’il avait contractée certainement dans un bordel de Cologne en février 1865 (bien qu’il prétendit n’y avoir rien touché d’autre qu’un piano).[4]» De Bottom sous-estime de loin les difficultés de Nietzsche dans sa rencontre de la métaphore phallique. Paul Deussen[5], en effet, mentionne cet épisode en citant la version du philosophe lui-même :
« Un jour, en février 1865, Nietzsche était allé seul à Cologne ; là, il s’était fait montrer par un domestique les curiosités de la ville, et à la fin il demanda à cet homme de le conduire dans un restaurant. Le serviteur l’amena dans une maison close. « Je me suis vu soudain, me raconta Nietzsche le lendemain, entouré d’une demi-douzaine d’apparitions en paillettes et gaze, qui me regardaient pleines d’attentes. Je restai là un moment muet. Puis j’allai instinctivement au piano comme vers le seul être doué d’une âme dans cette société, et je plaquai quelques accords. Ils secouèrent ma stupeur et je regagnai l’air libre. »
![]() Cet épisode est
peut-être le fait d’une simple timidité sexuelle de Nietzsche mais il
nous semble paradigmatique d’une impossibilité plus profonde liée au vide
de la métaphore phallique. La musique joue ici le rôle de supplétif à
la terreur engendrée par l’incapacité à répondre à la situation. Nous
aurons à revenir sur la signification de la musique associée à l’image
du père forclos et au côté dionysiaque de la jouissance extatique qu’elle
engendre dans le corps du philosophe.
Cet épisode est
peut-être le fait d’une simple timidité sexuelle de Nietzsche mais il
nous semble paradigmatique d’une impossibilité plus profonde liée au vide
de la métaphore phallique. La musique joue ici le rôle de supplétif à
la terreur engendrée par l’incapacité à répondre à la situation. Nous
aurons à revenir sur la signification de la musique associée à l’image
du père forclos et au côté dionysiaque de la jouissance extatique qu’elle
engendre dans le corps du philosophe.
Les bizarreries du philosophe
Plus fondamentalement il semble important de reprendre à notre compte un certain nombre « d’excentricités » dans la vie du philosophe pour repérer la structure de la psychose si l’on veut avancer une hypothèse cohérente sur sa maladie.
![]() Les excentricités
et les bouffonneries de Nietzsche sont très nombreuses. Elles sont connues
de ses biographes et de ses amis. Ces bizarreries sont liées aux états
hypomaniaques qui lui procuraient un ravissement extatique et qui l’ont
mis sur la voie de ses plus belles créations poétiques : celles de
Zarathoustra et de Dionysos. En voici par exemple quelques unes :
Les excentricités
et les bouffonneries de Nietzsche sont très nombreuses. Elles sont connues
de ses biographes et de ses amis. Ces bizarreries sont liées aux états
hypomaniaques qui lui procuraient un ravissement extatique et qui l’ont
mis sur la voie de ses plus belles créations poétiques : celles de
Zarathoustra et de Dionysos. En voici par exemple quelques unes :
![]() En 1880, dans sa
correspondance, le philosophe raconte qu’il est surpris dans la forêt
par un promeneur qui le dévisage longuement. Nietzsche se rend compte
alors qu’il avait sur son visage un rictus du bonheur qui l’accompagnait
depuis longtemps dans sa promenade. Paul Lansky raconte qu’on pouvait
observer Nietzsche en 1886 sur la Promenade des Anglais marcher d’un pas
singulier qui avait l’allure d’une danse. Nietzsche
bondissait, gambadait, il interrompait ses petits sauts en prenant des
notes sur un carnet[6].
En 1880, dans sa
correspondance, le philosophe raconte qu’il est surpris dans la forêt
par un promeneur qui le dévisage longuement. Nietzsche se rend compte
alors qu’il avait sur son visage un rictus du bonheur qui l’accompagnait
depuis longtemps dans sa promenade. Paul Lansky raconte qu’on pouvait
observer Nietzsche en 1886 sur la Promenade des Anglais marcher d’un pas
singulier qui avait l’allure d’une danse. Nietzsche
bondissait, gambadait, il interrompait ses petits sauts en prenant des
notes sur un carnet[6].
Le philosophe en sait quelque chose :
« Je me livre à tant de stupides facéties envers moi-même, et j’ai tant d’idées dignes d’un pitre sans public qu’il m’arrive en pleine rue de ricaner comme un idiot pendant une demi-heure, je ne trouve pas d’autres mots… »
Il revendique ses propres bizarreries comme une marque de supériorité de son génie. C'est courant à cette époque, en France, les génies de la littérature, les "poètes maudits" finissent ainsi, en marge de la société : Beaudelaire se drogue au haschisch et contracte la syphilis, Verlaine se noie dans l'alcool, Gérard de Nerval finit, malade, par se pendre, Rimbaud va se perdre dans les colonies et meurt amputé de la jambe à 37 ans...
![]() Les périodes hypomaniaques
sont fertiles en inspiration. Elles s’accompagnent d’une fuite des idées
contrôlée. Durant ses « excentricités » Nietzsche est son propre
observateur : il s’observe lui-même en pleine exubérance créatrice
laquelle se déroule dans une sorte de « rêverie parlée et minée ».
Nietzsche affirme « avoir la tête pleine de poésie la plus effrénée
qui soit jamais venue à l’esprit d’un poète. » Son rapport au langage
se place alors sur le versant de l’automatisme. La manie contrôlée n’est-elle
pas l’essence de l’inspiration ? Est-ce là le secret de Nietzsche
qui lui permet de placer sa prose au dessus de celle de Goethe ?
Les périodes hypomaniaques
sont fertiles en inspiration. Elles s’accompagnent d’une fuite des idées
contrôlée. Durant ses « excentricités » Nietzsche est son propre
observateur : il s’observe lui-même en pleine exubérance créatrice
laquelle se déroule dans une sorte de « rêverie parlée et minée ».
Nietzsche affirme « avoir la tête pleine de poésie la plus effrénée
qui soit jamais venue à l’esprit d’un poète. » Son rapport au langage
se place alors sur le versant de l’automatisme. La manie contrôlée n’est-elle
pas l’essence de l’inspiration ? Est-ce là le secret de Nietzsche
qui lui permet de placer sa prose au dessus de celle de Goethe ?
![]() Les phénomènes de
fuite des idées étaient liés à des phénomènes d’hallucinations visuelles.
En 1884 Nietzsche se plaint d’une hallucination qui l’assaillait sitôt
qu’il fermait les yeux. Il voyait une profusion de fleurs fantastiques
qui se nouaient et s’entrelaçaient en un perpétuel jaillissement. Plus
célèbre peut-être est l’hallucination de Rapallo où Nietzsche au cours
d’une promenade vers midi voit clairement Zarathoustra le dépasser et
se poser devant lui.
Les phénomènes de
fuite des idées étaient liés à des phénomènes d’hallucinations visuelles.
En 1884 Nietzsche se plaint d’une hallucination qui l’assaillait sitôt
qu’il fermait les yeux. Il voyait une profusion de fleurs fantastiques
qui se nouaient et s’entrelaçaient en un perpétuel jaillissement. Plus
célèbre peut-être est l’hallucination de Rapallo où Nietzsche au cours
d’une promenade vers midi voit clairement Zarathoustra le dépasser et
se poser devant lui.
Rüdiger Safranski dans sa biographie mentionne cette hallucination du 31 décembre 1864 sans mettre le doigt dessus. Nietzsche est seul dans sa chambre d’étudiant à Bonn. Il s’assoupit dans une profonde rêverie après avoir joué le Requiem de Manfred de Schumann au Piano. En ouvrant distinctement les yeux :
![]() « Là sur le
lit, il croit voir quelqu’un couché, gémissant doucement, râlant. Un mourant !
il se sent entouré d’ombres. Elles chuchotent et murmurent quelque chose
au mourant. Et là tout à coup, il le sait, c’est la vieille année qui
meurt là. Quelques instants plus tard, le lit est vide.[7] »
« Là sur le
lit, il croit voir quelqu’un couché, gémissant doucement, râlant. Un mourant !
il se sent entouré d’ombres. Elles chuchotent et murmurent quelque chose
au mourant. Et là tout à coup, il le sait, c’est la vieille année qui
meurt là. Quelques instants plus tard, le lit est vide.[7] »
![]() La solitude, la
musique, le requiem, l’hallucination du père mort aussitôt non reconnu
ne nous apparaissent pas comme des « détails biographiques »
comme les autres. Il faut considérer la bio-graphie comme un texte,
signé du philosophe, non lu à défaut d’avoir été écrit de son existence
mais prenant part à l’œuvre qui n’est jamais qu’un des textes possibles
de « l’auteur ». L’auteur étant joué lui-même par le langage
qui traverse son existence et dont il constate l’impossibilité d’en être
le sujet imaginaire sinon le réceptacle. Nietzsche ne cessera de le théoriser,
tant il était dépossédé de lui-même par des phases de dépersonnalisation.
La solitude, la
musique, le requiem, l’hallucination du père mort aussitôt non reconnu
ne nous apparaissent pas comme des « détails biographiques »
comme les autres. Il faut considérer la bio-graphie comme un texte,
signé du philosophe, non lu à défaut d’avoir été écrit de son existence
mais prenant part à l’œuvre qui n’est jamais qu’un des textes possibles
de « l’auteur ». L’auteur étant joué lui-même par le langage
qui traverse son existence et dont il constate l’impossibilité d’en être
le sujet imaginaire sinon le réceptacle. Nietzsche ne cessera de le théoriser,
tant il était dépossédé de lui-même par des phases de dépersonnalisation.
![]() Les hallucinations
et les phases extatiques entourent la création littéraire et constituent
« le monde ambiant» du philosophe mais pas seulement. Ces phases
alternent avec de très violentes tempêtes dépressives dans lesquelles
la maladie cloue Nietzsche dans le fond d’un gouffre et constituent l’autre
extrême des phases spectaculaires extatiques. Le philosophe ne peut plus
écrire. Il se sent oppressé dans son corps, écrasé dans le fond de l’être
par la douleur. L’alternance de ces phases avec leur incessant caprice
et leur permanente dépossession de soi l’ont mis sur la voie de l’intuition
de « l’éternel retour » et de « la volonté de puissance ».
Les hallucinations
et les phases extatiques entourent la création littéraire et constituent
« le monde ambiant» du philosophe mais pas seulement. Ces phases
alternent avec de très violentes tempêtes dépressives dans lesquelles
la maladie cloue Nietzsche dans le fond d’un gouffre et constituent l’autre
extrême des phases spectaculaires extatiques. Le philosophe ne peut plus
écrire. Il se sent oppressé dans son corps, écrasé dans le fond de l’être
par la douleur. L’alternance de ces phases avec leur incessant caprice
et leur permanente dépossession de soi l’ont mis sur la voie de l’intuition
de « l’éternel retour » et de « la volonté de puissance ».
L’automne Merveilleux
![]() Nous pouvons repartir
pour le lecteur de la crise de 1888 qui précède l’effondrement de Turin
pour nous introduire dans le climat de la psychose du philosophe.
Le 3 janvier 1889 à Turin Nietzsche éclata en sanglots sur la Piazza Carlo
Alberto et se jeta au cou d’un cheval battu [8].
Une fois ramené à sa pension, il projeta d’abattre le Kaiser et de faire
la guerre aux antisémites. Il était persuadé qu’il était Dionysos. Sa
correspondance atteste qu’il signait ses dernières lettres Le Crucifié,
Dieu, Le roi D’Italie, le Bouddha, Alexandre le Grand, Richard Wagner…
Dans une lettre du 6 janvier 1889 Nietzsche écrit à son ami Jacob Burckhardt :
Nous pouvons repartir
pour le lecteur de la crise de 1888 qui précède l’effondrement de Turin
pour nous introduire dans le climat de la psychose du philosophe.
Le 3 janvier 1889 à Turin Nietzsche éclata en sanglots sur la Piazza Carlo
Alberto et se jeta au cou d’un cheval battu [8].
Une fois ramené à sa pension, il projeta d’abattre le Kaiser et de faire
la guerre aux antisémites. Il était persuadé qu’il était Dionysos. Sa
correspondance atteste qu’il signait ses dernières lettres Le Crucifié,
Dieu, Le roi D’Italie, le Bouddha, Alexandre le Grand, Richard Wagner…
Dans une lettre du 6 janvier 1889 Nietzsche écrit à son ami Jacob Burckhardt :
« Finalement je préférais de beaucoup être professeur à Bâle qu’être Dieu ; mais je n’ai pas osé pousser si loin mon égoïsme personnel pour ne plus m’occuper de la création du monde. Vous (...)
![]() Après avoir reçu
cette lettre, Burckhardt, alerte un ami de Nietzsche et le prie de le
prendre sous sa garde. Overbeck part aussitôt pour Turin et voici ce qu’il
raconte :
Après avoir reçu
cette lettre, Burckhardt, alerte un ami de Nietzsche et le prie de le
prendre sous sa garde. Overbeck part aussitôt pour Turin et voici ce qu’il
raconte :
« J’aperçois Nietzsche au coin d’un canapé, accroupi et lisant. Le maître incomparable de la langue était hors d’état de rendre lui-même les ravissements de son allégresse autrement que par des expressions les plus vulgaires ou par des danses et des bonds grotesques. »
![]() D’octobre à décembre
1888, Nietzsche était entré dans ce qu’il nomme lui-même « l’automne
merveilleux ». Dans une lettre à son éditeur il vante son excellente
santé physique. « Pas une seule mauvaise journée jusqu’à présent »,
cela signifie aucun état migraineux et dépressif, états qui le persécutent
depuis l’adolescence. Nietzsche admire son portrait dans une glace :
il paraît avoir 10 ans de moins. Il raconte cependant ce qu’il nomme :
« la complète fascination sur les turinois » : « Quand
j’entre dans un magasin, écrit-il à Peter Gast, tous les visages
changent ; dans la rue les femmes me regardent ; ma vieille
marchande des quatre saisons me réserve les grappes les plus mûres et
a baissé ses prix pour moi ». « Je mange dans l’une des
premières trattoria où l’on me donne les mets les plus choisis. »
« Je jouis des services d’un excellent tailleur» « tout
me devient facile, tout me réussit » « Personne ne m’a
encore pris pour un Allemand ». Il ne s’agit pas simplement d’humour
ou de bouffonnerie. Nietzsche est sous l’influence une phase hypomaniaque
qui s’empare de lui sous la forme d’un délire continu : erreurs d’interprétation,
hallucinations, climat d’euphorie et d’optimisme délirant. Pourtant ce
climat est propice à la création littéraire. C’est dans
cette période qu’il écrit l’un de ses livres les plus incroyables :
Ecce Homo [10].
Ouvrage que l’on peut identifier d’une certaine façon au Horla
de Maupassant où l’écrivain est à la fois sous l’influence et dans le
témoignage de sa propre « folie ».
D’octobre à décembre
1888, Nietzsche était entré dans ce qu’il nomme lui-même « l’automne
merveilleux ». Dans une lettre à son éditeur il vante son excellente
santé physique. « Pas une seule mauvaise journée jusqu’à présent »,
cela signifie aucun état migraineux et dépressif, états qui le persécutent
depuis l’adolescence. Nietzsche admire son portrait dans une glace :
il paraît avoir 10 ans de moins. Il raconte cependant ce qu’il nomme :
« la complète fascination sur les turinois » : « Quand
j’entre dans un magasin, écrit-il à Peter Gast, tous les visages
changent ; dans la rue les femmes me regardent ; ma vieille
marchande des quatre saisons me réserve les grappes les plus mûres et
a baissé ses prix pour moi ». « Je mange dans l’une des
premières trattoria où l’on me donne les mets les plus choisis. »
« Je jouis des services d’un excellent tailleur» « tout
me devient facile, tout me réussit » « Personne ne m’a
encore pris pour un Allemand ». Il ne s’agit pas simplement d’humour
ou de bouffonnerie. Nietzsche est sous l’influence une phase hypomaniaque
qui s’empare de lui sous la forme d’un délire continu : erreurs d’interprétation,
hallucinations, climat d’euphorie et d’optimisme délirant. Pourtant ce
climat est propice à la création littéraire. C’est dans
cette période qu’il écrit l’un de ses livres les plus incroyables :
Ecce Homo [10].
Ouvrage que l’on peut identifier d’une certaine façon au Horla
de Maupassant où l’écrivain est à la fois sous l’influence et dans le
témoignage de sa propre « folie ».
Manie et mégalomanie
![]() Tantôt le délire
envahit sa pensée sur le mode hypomaniaque, où le sujet conserve une activité
critique très cohérente. Tantôt le délire devient véritablement maniaque
avec disparition de la conscience critique, toute puissance des idées
et extravagance. La limite entre les deux états est difficile dans cette
période à discerner comme en témoignent les dernières lettres du Philosophe.
La pensée reste cohérente avec la philosophie de Nietzsche. Simplement
les thèmes principaux sont le délire mégalomane avec des idées de grandeurs
et de surestimation de soi et des relations privilégiées du sujet avec
Dieu et des personnages illustres de l’histoire (thèmes essentiellement
maniaques). Nietzsche proclame qu’il est un destin historique. Le philosophe
qui a entendu l’événement de la mort de Dieu, celui qui a dévoilé la venue
d’un monde sans Dieu, celui-là même se prend pour Dieu dans une identification
mégalomaniaque ultime. A cet instant il ne s’agit plus d’une simple élaboration
littéraire. A ce titre le texte qu’il écrit dans Le
Gai Savoir quelques années auparavant et qui se nomme L’insensé
est un texte prophétique du destin de Nietzsche. La mort de Dieu est alors
liée à l’apparition de la folie. Seul « l’insensé » saisit la
mort de Dieu comme événement apparu dans le réel et encore
ignoré de la compréhension générale, il proclame l’existence d’un crime
en commun et doit payer de sa raison cette découverte. Les « outrances »
de Nietzsche (« Pourquoi je suis si sage », « Pourquoi
je suis si malin », « Pourquoi j’écris de si bons livres »
« Pourquoi je suis un destin »[11])
ne sont pas simplement des provocations volontaires ou des tours de bouffonnerie.
Nietzsche est mégalomane depuis très longtemps. Dès 1880 il s’estime au
dessus de Goethe, Schopenhauer, de Wagner. Dans Ecce Homo
il se pose comme un grand maître de l’humanité, le premier esprit de tous
les millénaires, sa « mission » est universelle et fera éclater
l’humanité en deux : l’humanité avant lui et l’humanité après lui.
Il brandit le spectre de la forclusion. Il ne s’agit plus vraiment d’humour.
Il s’agit d’un symptôme caricatural mégalomaniaque de la psychose maniaco-dépressive
qui coexiste avec des constructions philosophiques plus rationnelles.
Cela donne parfois un discours mixte à la limite entre le délire paranoïaque
et la pensée rationnelle dans une sorte de mélange des deux où le statut
de maître du monde est parfaitement naturel. Le philosophe prend pour
réelles les pensées nées de ses accès maniaques. Si la manie est une
défense contre la mélancolie il faut comprendre « l’automne merveilleux »
de Nietzsche comme un état de très profonde souffrance (où la douleur
d’exister est en réalité à son comble) mais dans lequel le sujet parvient
par une défense délirante à fuir sa propre détérioration dans le réel.
Tantôt le délire
envahit sa pensée sur le mode hypomaniaque, où le sujet conserve une activité
critique très cohérente. Tantôt le délire devient véritablement maniaque
avec disparition de la conscience critique, toute puissance des idées
et extravagance. La limite entre les deux états est difficile dans cette
période à discerner comme en témoignent les dernières lettres du Philosophe.
La pensée reste cohérente avec la philosophie de Nietzsche. Simplement
les thèmes principaux sont le délire mégalomane avec des idées de grandeurs
et de surestimation de soi et des relations privilégiées du sujet avec
Dieu et des personnages illustres de l’histoire (thèmes essentiellement
maniaques). Nietzsche proclame qu’il est un destin historique. Le philosophe
qui a entendu l’événement de la mort de Dieu, celui qui a dévoilé la venue
d’un monde sans Dieu, celui-là même se prend pour Dieu dans une identification
mégalomaniaque ultime. A cet instant il ne s’agit plus d’une simple élaboration
littéraire. A ce titre le texte qu’il écrit dans Le
Gai Savoir quelques années auparavant et qui se nomme L’insensé
est un texte prophétique du destin de Nietzsche. La mort de Dieu est alors
liée à l’apparition de la folie. Seul « l’insensé » saisit la
mort de Dieu comme événement apparu dans le réel et encore
ignoré de la compréhension générale, il proclame l’existence d’un crime
en commun et doit payer de sa raison cette découverte. Les « outrances »
de Nietzsche (« Pourquoi je suis si sage », « Pourquoi
je suis si malin », « Pourquoi j’écris de si bons livres »
« Pourquoi je suis un destin »[11])
ne sont pas simplement des provocations volontaires ou des tours de bouffonnerie.
Nietzsche est mégalomane depuis très longtemps. Dès 1880 il s’estime au
dessus de Goethe, Schopenhauer, de Wagner. Dans Ecce Homo
il se pose comme un grand maître de l’humanité, le premier esprit de tous
les millénaires, sa « mission » est universelle et fera éclater
l’humanité en deux : l’humanité avant lui et l’humanité après lui.
Il brandit le spectre de la forclusion. Il ne s’agit plus vraiment d’humour.
Il s’agit d’un symptôme caricatural mégalomaniaque de la psychose maniaco-dépressive
qui coexiste avec des constructions philosophiques plus rationnelles.
Cela donne parfois un discours mixte à la limite entre le délire paranoïaque
et la pensée rationnelle dans une sorte de mélange des deux où le statut
de maître du monde est parfaitement naturel. Le philosophe prend pour
réelles les pensées nées de ses accès maniaques. Si la manie est une
défense contre la mélancolie il faut comprendre « l’automne merveilleux »
de Nietzsche comme un état de très profonde souffrance (où la douleur
d’exister est en réalité à son comble) mais dans lequel le sujet parvient
par une défense délirante à fuir sa propre détérioration dans le réel.
Les thèmes de la psychose
![]() Durant la crise
de janvier 1889, la révolte de Nietzsche explose à ciel ouvert. Les thèmes
de cette insurrection sont très instructifs. Deux sujets au moins la dominent.
Durant la crise
de janvier 1889, la révolte de Nietzsche explose à ciel ouvert. Les thèmes
de cette insurrection sont très instructifs. Deux sujets au moins la dominent.
1) La haine de l’Allemagne est l’un des thèmes qui prédominent la dernière période du philosophe. Il veut cesser de parler et d’écrire Allemand. Ce rejet a quelque chose de la forclusion. « De tout mon instinct j’ai déclaré la guerre à l’Allemagne ». Il veut créer une ligue contre l’Allemagne, la rend responsable de « tous les crimes commis contre la culture depuis 4 siècles[12] ». Il veut faire fusiller le jeune Kaiser[13].
2) La haine du christianisme : autre thème de la forclusion. Contre le crucifié, le pape, le christianisme. Dieu est aboli par Nietzsche et le philosophe est prêt à gouverner l’univers. Il jette le pape en Prison. Déclare qu’il est déshonorant et malpropre d’être chrétien. Voilà comment Nietzsche voit dans sa correspondance son dernier livre :
« Ecce Homo est un attentat sans aucun ménagement contre le crucifié ; il finit dans un fracas de tonnerre et de fulmination contre tout ce qui est chrétien ou infecté de christianisme[14]. »
![]() Le
philosophe se prend alors pour un fondateur de religion – acte sans précédent
dans l’histoire de la pensée occidentale. De quel Dieu s’agit-il dès lors
si ce n’est pas le Dieu chrétien ? Il s’agit de Dionysos. Nietzsche
est alors le siège d’une double identification et il lutte pour la domination
de l’une d’entre elle. D’un côté le Dieu chrétien qu’il nomme « le
crucifié » auquel il fait jouer le rôle du persécuteur et de l’autre
le dieu païen Dionysos, le dieu libérateur.
Le
philosophe se prend alors pour un fondateur de religion – acte sans précédent
dans l’histoire de la pensée occidentale. De quel Dieu s’agit-il dès lors
si ce n’est pas le Dieu chrétien ? Il s’agit de Dionysos. Nietzsche
est alors le siège d’une double identification et il lutte pour la domination
de l’une d’entre elle. D’un côté le Dieu chrétien qu’il nomme « le
crucifié » auquel il fait jouer le rôle du persécuteur et de l’autre
le dieu païen Dionysos, le dieu libérateur.
![]() « M’a-t-on
compris ? - demande Nietzsche à la fin D’Ecce Homo – Dionysos
face au Crucifié[15] »
« M’a-t-on
compris ? - demande Nietzsche à la fin D’Ecce Homo – Dionysos
face au Crucifié[15] »
Cette identification bipolaire Dionysos/Crucifié est d’un côté une création philosophique radicalement originale dans l’histoire de la pensée (qui marque un retour au paganisme) de l’autre une élaboration paradigmatique de sa maladie.
![]() Le « Crucifié »
représente le procès que Nietzsche intente à toute la tradition onto-théologique
la philosophie. Cette identification renvoie d’autre part aux périodes
de mélancolie dominées par le délire de culpabilité; d’angoisse et d’indignité
morale voire par les idées de suicide. Elle circonscrit la pulsion de
mort. Ces périodes dépressives (dominées par le surmoi) sont des périodes
de dégoût de la vie. Elles sont la proie d’une très violente hypocondrie
(migraines, myopie et vomissements qui nécessitent plusieurs fois par
mois l’alitement et l’abandon de toute activité).
Le « Crucifié »
représente le procès que Nietzsche intente à toute la tradition onto-théologique
la philosophie. Cette identification renvoie d’autre part aux périodes
de mélancolie dominées par le délire de culpabilité; d’angoisse et d’indignité
morale voire par les idées de suicide. Elle circonscrit la pulsion de
mort. Ces périodes dépressives (dominées par le surmoi) sont des périodes
de dégoût de la vie. Elles sont la proie d’une très violente hypocondrie
(migraines, myopie et vomissements qui nécessitent plusieurs fois par
mois l’alitement et l’abandon de toute activité).
![]() Par opposition Dionysos
représente les phases maniaques (dominée par le ça) de la personnalité
de Nietzsche, le renversement de la maladie par l’ivresse, le surmontement
de la négativité, mais aussi la domination extatique, la violence d’une
jouissance énigmatique diffuse dans corps, que lui procure l’excitation
marquée par le sentiment de puissance retrouvée.
Par opposition Dionysos
représente les phases maniaques (dominée par le ça) de la personnalité
de Nietzsche, le renversement de la maladie par l’ivresse, le surmontement
de la négativité, mais aussi la domination extatique, la violence d’une
jouissance énigmatique diffuse dans corps, que lui procure l’excitation
marquée par le sentiment de puissance retrouvée.
![]() Chacune de ces identifications
marque l’un des pôles de la maladie de l’humeur. Ils constituent une dualité
(celle du surmoi et du ça par exemple) au cœur même de la personnalité
de Nietzsche dont ils sont indissociables. Toute la philosophie de Nietzsche
est liée à la lutte des contraires dans une dimension héraclitéenne. C’est
contre lui-même qu’il s’explique, contre sa propre dissociation, contre
son penchant à la mélancolie dont il impute la cause au pathos du christianisme.
Nietzsche transforme sa maladie en problème de civilisation dont la solution
consiste alors à surmonter les valeurs du christianisme considérées comme
décadentes en soi.
Chacune de ces identifications
marque l’un des pôles de la maladie de l’humeur. Ils constituent une dualité
(celle du surmoi et du ça par exemple) au cœur même de la personnalité
de Nietzsche dont ils sont indissociables. Toute la philosophie de Nietzsche
est liée à la lutte des contraires dans une dimension héraclitéenne. C’est
contre lui-même qu’il s’explique, contre sa propre dissociation, contre
son penchant à la mélancolie dont il impute la cause au pathos du christianisme.
Nietzsche transforme sa maladie en problème de civilisation dont la solution
consiste alors à surmonter les valeurs du christianisme considérées comme
décadentes en soi.
Quelque chose de pourri au royaume de Dieu
![]() La mort de Dieu
est donc le point de départ de la philosophie de Nietzsche. La question
du deuil de Dieu est la question centrale de sa philosophie : penser
une philosophie de l’après-Dieu qui surmonte deux mille ans d’histoire
en Occident. Le projet d’une « transvaluation » ou d’une « inversion »
de toutes les valeurs est alors le but de la philosophie. Ce que Nietzsche
appelle « inversion des valeurs » est la trace du nihilisme
contemporain. Il s’agit d’un projet d’un radicalisme jamais exercé que
seul un « esprit libre » pouvait accomplir. Il ne s’agit pas
simplement d’interroger et de réexaminer un certain nombre de croyances
et de constructions de la pensée de la tradition chrétienne mais de renverser
et détruire toutes les anciennes idoles (comme cela de la loi morale)
devenues une simple fable. Il faut reconstruire ex-nihilo les nouvelles
tables de la loi ainsi qu’une nouvelle humanité (l’humanité du surhomme).
On n’est pas exactement dans une logique sceptique mais plutôt dans une
logique affirmative. Il n’y a pas non plus de place pour une dialectique
des éléments. On est dans une logique à deux valeurs. Le christianisme
est l’essence de la décadence : il doit être détruit définitivement
pour laisser place à Dionysos.
La mort de Dieu
est donc le point de départ de la philosophie de Nietzsche. La question
du deuil de Dieu est la question centrale de sa philosophie : penser
une philosophie de l’après-Dieu qui surmonte deux mille ans d’histoire
en Occident. Le projet d’une « transvaluation » ou d’une « inversion »
de toutes les valeurs est alors le but de la philosophie. Ce que Nietzsche
appelle « inversion des valeurs » est la trace du nihilisme
contemporain. Il s’agit d’un projet d’un radicalisme jamais exercé que
seul un « esprit libre » pouvait accomplir. Il ne s’agit pas
simplement d’interroger et de réexaminer un certain nombre de croyances
et de constructions de la pensée de la tradition chrétienne mais de renverser
et détruire toutes les anciennes idoles (comme cela de la loi morale)
devenues une simple fable. Il faut reconstruire ex-nihilo les nouvelles
tables de la loi ainsi qu’une nouvelle humanité (l’humanité du surhomme).
On n’est pas exactement dans une logique sceptique mais plutôt dans une
logique affirmative. Il n’y a pas non plus de place pour une dialectique
des éléments. On est dans une logique à deux valeurs. Le christianisme
est l’essence de la décadence : il doit être détruit définitivement
pour laisser place à Dionysos.
![]() Si Dieu est mort.
Alors tout est faux. Il n’y a pas d’arrières mondes, ni de valeurs absolues
idéales et éternelles qui puissent servir de refuge, de consolation, de
justificatif. La figure de l’humanité chrétienne elle-même est morte parce
qu’elle n’a plus de raison d’être. Toute la trajectoire de la pensée nietzschéenne
sera donc de liquider le christianisme et de préparer le dépassement
de la métaphysique. Or à mesure que la philosophie de Nietzsche va
solder la mort de Dieu, il semble que le philosophe ne pourra pas empêcher
son suicide. Tout se passe comme si Nietzsche s’attaquait à une identification
dont le centre est en lui et il dont il n’arrive précisément pas à se
dessaisir. Il est intéressant comme nous l’avons déjà
fait remarquer de voir que l’homme qui proclame la mort de Dieu se prend
lui-même pour Dieu au moment de son « débranchement »[16].
C’est ici que nous devons compléter notre hypothèse concernant la mélancolie
de Nietzsche. Nous supposons que la mort de Dieu renvoie à un thème plus
intime de la vie de Nietzsche : la perte de son propre père. Nietzsche
perd son père, le pasteur de Rocken, à l’âge de 5 ans et ne réussira jamais
à en faire le deuil. Le père mort est forclos. Le christianisme représente
avant tout la filiation de Nietzsche et l’identification au père mort,
identification mortifère contre laquelle il ne cesse d’essayer de se déprendre
et qui finit par le rejoindre, montrant en quoi le délire de culpabilité,
hors de tout langage, précipite le destin intellectuel de Nietzsche dans
la démence.
Si Dieu est mort.
Alors tout est faux. Il n’y a pas d’arrières mondes, ni de valeurs absolues
idéales et éternelles qui puissent servir de refuge, de consolation, de
justificatif. La figure de l’humanité chrétienne elle-même est morte parce
qu’elle n’a plus de raison d’être. Toute la trajectoire de la pensée nietzschéenne
sera donc de liquider le christianisme et de préparer le dépassement
de la métaphysique. Or à mesure que la philosophie de Nietzsche va
solder la mort de Dieu, il semble que le philosophe ne pourra pas empêcher
son suicide. Tout se passe comme si Nietzsche s’attaquait à une identification
dont le centre est en lui et il dont il n’arrive précisément pas à se
dessaisir. Il est intéressant comme nous l’avons déjà
fait remarquer de voir que l’homme qui proclame la mort de Dieu se prend
lui-même pour Dieu au moment de son « débranchement »[16].
C’est ici que nous devons compléter notre hypothèse concernant la mélancolie
de Nietzsche. Nous supposons que la mort de Dieu renvoie à un thème plus
intime de la vie de Nietzsche : la perte de son propre père. Nietzsche
perd son père, le pasteur de Rocken, à l’âge de 5 ans et ne réussira jamais
à en faire le deuil. Le père mort est forclos. Le christianisme représente
avant tout la filiation de Nietzsche et l’identification au père mort,
identification mortifère contre laquelle il ne cesse d’essayer de se déprendre
et qui finit par le rejoindre, montrant en quoi le délire de culpabilité,
hors de tout langage, précipite le destin intellectuel de Nietzsche dans
la démence.
La domination du père mort
![]() Plusieurs indices
nous montrent la domination du père mort dans les symptômes de la psychose
du philosophe :
Plusieurs indices
nous montrent la domination du père mort dans les symptômes de la psychose
du philosophe :
1) Les symptômes de l’hypocondrie de Nietzsche : migraines et myopie sont des syndromes hérités du père. Karl Ludwig Nietzsche est mort d’une tumeur au cerveau. Cette affection se manifesta par de violents maux de tête, des vomissements, des troubles visuels et des manifestations aphasiques. Ces symptômes ressemblent à la maladie que Nietzsche traversera toute sa vie dans les phases dépressives. Qu’il s’agisse d’hérédité physiologique ou non, on ne peut évacuer l’idée d’une répétition de la mort du père au cœur même des troubles de la maladie du fils. Commémoration d’un réel, répétition, similarité de destin. L’ombre du père plane sur la santé permanente du philosophe. Le père comme « au-delà » menace le présent dont il ne fait plus qu’une ombre. Nous ne cesserons d’en retrouver la confirmation dans les moments cruciaux de la vie du philosophe.
2) « L’échec professionnel » de la période de Bâle où Nietzsche fait le choix définitif de la philosophie est lié à la progression endogène de la pulsion de mort. Nietzsche va nous en fournir lui-même l’explication dans Ecce Homo dès les premières lignes de son livre à partir de cette phrase : « Je suis pour m’exprimer sous une forme énigmatique, déjà mort en tant que je suis mon propre père ; ce que je tiens de ma mère vit encore et vieillit en moi. » [17] Cette énigme tend à confirmer que Nietzsche se vivait déjà mort par identification au père. Quelques lignes plus bas nous le confirment : « Mon père est mort à l’âge de 36 ans (en français dans le texte). Il était délicat, bienveillant et morbide, tel un être qui n’est prédestiné qu’à passer – évoquant plutôt l’image d’un bienveillant souvenir de la vie que la vie elle-même. Son existence déclina au même âge que la mienne : à trente-six ans je parvins au point inférieur de ma vitalité. Je vivais encore mais sans être capable de voir à trois pas devant moi. A cette époque – c’était en 1879 – j’abandonnais mon poste de professeur à Bâle, je vécus comme une ombre…[18] » Le fait que le père de Nietzsche soit mort jeune a fait planer sur la vie de Nietzsche une menace constante[19]. L’imminence de la mort et la prédestination à une fin prématurée sont donc à l’origine du moment crucial du choix de son existence chez Nietzsche et c’est donc à la progression de la psychose que l’on doit cette réorientation. La nouvelle existence de Nietzsche, entièrement disponible à la création de son œuvre s’accompagne d’une errance européenne que le philosophe transforme en quête spirituelle. Dans cette errance le philosophe sort d’Allemagne et gagne progressivement la méditerranée et l’Italie (vers la Grèce, berceau de Dionysos ?). Cette errance est liée à la forclusion du nom du père, un exil du père en quelque sorte, autant sur le plan géographique que sur le plan intellectuel[20], à la recherche du dépassement de l’Allemagne et du christianisme – les signifiants attachés à la transmission familiale dont Nietzsche rêve la destruction et pas simplement le surmontement.
3) La forclusion du nom du père produit dans Ecce Homo un délire de filiation : Nietzsche refuse le signifiant Allemand. Il s’invente une filiation polonaise[21]. Ce rejet de sa filiation, s’il a quelque de drôle dans sa littérature parce qu’il se donne des alibis philosophiques, est en même temps délirant. D’après une étude rigoureuse de sa généalogie effectuée par Charles Andler, la famille Nietzsche est entièrement allemande. Ces éléments nous mettent en présence d’une pensée de l’abjection du nom propre.
4) Nous émettons l’hypothèse que la solitude de Nietzsche est liée à l’absence de l’opérateur phallique[22] et que la musique étayait chez lui le vide de la métaphore phallique. La musique nous mène directement sur la trace du père. Nietzsche place l’improvisation musicale au dessus du plaisir sexuel. L’improvisation était aussi pour le père de Nietzsche ce qu’il prisait le plus. Il est à noter que Wagner (qui incarne incontestablement une figure du père) trouvait ridicules les improvisations du philosophe et que la seule tentative de publication d’une partition musicale se solde par un échec cuisant dans lequel l’éditeur trouve monstrueuse et entièrement discordante sa musique. Cette discordance échappait à Nietzsche qui se prenait pour un grand improvisateur. Ce « malentendu » nous semble intéressant parce qu’il dénote la discordance bien plus profonde de l’introjection de l’image du père qui nous mène sur la voix de la mégalomanie. Ce ratage central de l’introjection du père amène le sujet à une suite d’identifications mégalomaniaques destinées à combler le vide dépressif du moi et le vide de la métaphore paternelle.
La volonté de puissance comme passage en force sur la psychose
![]() Le concept de volonté
de puissance est pour nous le « cataplasme » que Nietzsche pose
sur le vide de la forclusion et le moyen par lequel il essaie de dépasser
l’anéantissement qui ne cesse jamais de le menacer. C’est le concept par
lequel le philosophe trouve un moyen de passer en force sur sa propre
« impuissance » dépressive. « Volonté de puissance »
signifie pour Nietzsche : recherche désespérée de la domination de
la mélancolie.
Le concept de volonté
de puissance est pour nous le « cataplasme » que Nietzsche pose
sur le vide de la forclusion et le moyen par lequel il essaie de dépasser
l’anéantissement qui ne cesse jamais de le menacer. C’est le concept par
lequel le philosophe trouve un moyen de passer en force sur sa propre
« impuissance » dépressive. « Volonté de puissance »
signifie pour Nietzsche : recherche désespérée de la domination de
la mélancolie.
![]() La volonté de puissance
est un « instinct » de domination de la vie, ce par quoi la
vie est ce qui doit toujours se surmonter soi-même. Se surmonter soi-même
signifie essentiellement « surmonter la tyrannie de la douleur »
et dans la vie personnelle de Nietzsche il s’agit de surmonter la douleur
morale des états dépressifs. L’existence est donc une longue chaîne de
dépassements de soi-même. Le sentiment de « puissance » le penseur
ne l’atteignait que dans les états hypomaniaques qui lui donnent une surabondance
de force, une exubérance de vie débordant la pensée, un sentiment de toute
puissance et d’excitation intellectuelle qui débouche sur une ivresse
créatrice extrême : c’est là avons-nous vu le point de rendez-vous
avec la manie. Cette volonté de puissance, ne nous y trompons pas, est
dépersonnalisée et Nietzsche la décrit comme un essor de l’être indépendant
de la conscience. Et pour cause, il subissait des cycles indépendants
de sa volonté dans lesquels sa force vitale était inhibée par les entraves
de la douleur des cycles de libération jubilatoire qui tout à coup le
déchaînait de l’impuissance de la dépression et de l’hypocondrie. Il est
à noter que dans la deuxième partie du Zarathoustra Nietzsche
associe la volonté de puissance à l’image de la résurrection des tombeaux :
« Oui, tu demeures pour moi la destructrice de tous les tombeaux :
salut à toi ma volonté ! et ce n’est que là où il y a des tombeaux
qu’il y a des résurrections ».Cette symbolique du tombeau marque une
fois de plus l’entreprise de la volonté devant la question de la perte
et du deuil, image récurrente.
La volonté de puissance
est un « instinct » de domination de la vie, ce par quoi la
vie est ce qui doit toujours se surmonter soi-même. Se surmonter soi-même
signifie essentiellement « surmonter la tyrannie de la douleur »
et dans la vie personnelle de Nietzsche il s’agit de surmonter la douleur
morale des états dépressifs. L’existence est donc une longue chaîne de
dépassements de soi-même. Le sentiment de « puissance » le penseur
ne l’atteignait que dans les états hypomaniaques qui lui donnent une surabondance
de force, une exubérance de vie débordant la pensée, un sentiment de toute
puissance et d’excitation intellectuelle qui débouche sur une ivresse
créatrice extrême : c’est là avons-nous vu le point de rendez-vous
avec la manie. Cette volonté de puissance, ne nous y trompons pas, est
dépersonnalisée et Nietzsche la décrit comme un essor de l’être indépendant
de la conscience. Et pour cause, il subissait des cycles indépendants
de sa volonté dans lesquels sa force vitale était inhibée par les entraves
de la douleur des cycles de libération jubilatoire qui tout à coup le
déchaînait de l’impuissance de la dépression et de l’hypocondrie. Il est
à noter que dans la deuxième partie du Zarathoustra Nietzsche
associe la volonté de puissance à l’image de la résurrection des tombeaux :
« Oui, tu demeures pour moi la destructrice de tous les tombeaux :
salut à toi ma volonté ! et ce n’est que là où il y a des tombeaux
qu’il y a des résurrections ».Cette symbolique du tombeau marque une
fois de plus l’entreprise de la volonté devant la question de la perte
et du deuil, image récurrente.
Le dualisme de la volonté de puissance et son échec dans le réel
![]() Ce concept aura
donc la marque de la structure bipolaire de la maladie et de la forclusion.
Il existe une volonté de puissance négative. La volonté réactive consiste
à dénigrer la vie, la rabaisser, la refuser à travers l’illusion, faire
privilégier la négation sur l’affirmation, la réaction sur l’action, la
volonté de nier sur la volonté de créer. Sa meilleure image est celle
du christianisme qui a besoin de l’illusion religieuse pour affronter
la vie. On voit bien que ce Nietzsche appelle le nihilisme
touche l’essence de la dépréciation négative de la mélancolie. La croyance
religieuse serait issue elle-même de l’occultation de la mélancolie dans
la métaphysique. Nul doute alors que le christianisme est alors porté
par le dégoût du monde. Il s’est détourné du réel pour pouvoir masquer
son origine et construire l’illusion d’un réel meilleur mais nécessairement
vide d’existence.
Ce concept aura
donc la marque de la structure bipolaire de la maladie et de la forclusion.
Il existe une volonté de puissance négative. La volonté réactive consiste
à dénigrer la vie, la rabaisser, la refuser à travers l’illusion, faire
privilégier la négation sur l’affirmation, la réaction sur l’action, la
volonté de nier sur la volonté de créer. Sa meilleure image est celle
du christianisme qui a besoin de l’illusion religieuse pour affronter
la vie. On voit bien que ce Nietzsche appelle le nihilisme
touche l’essence de la dépréciation négative de la mélancolie. La croyance
religieuse serait issue elle-même de l’occultation de la mélancolie dans
la métaphysique. Nul doute alors que le christianisme est alors porté
par le dégoût du monde. Il s’est détourné du réel pour pouvoir masquer
son origine et construire l’illusion d’un réel meilleur mais nécessairement
vide d’existence.
![]() Mais la volonté
pour Nietzsche peut se renverser en volonté de puissance affirmative.
Son intention est d’être créatrice, elle détruit les anciennes valeurs
pour en établir de nouvelles. Elle consiste à créer, vouloir le réel tel
qu’il est et non le réel fabriqué à partir de l’illusion religieuse. Sa
meilleure image est celle de Dionysos. La vraie volonté de puissance est
donc liée à la manie. Elle est avant tout cette force impersonnelle
de la psychose qui traverse Nietzsche et qui décide des modifications
substantielles dans l’humeur et dans le corps du penseur.
Mais la volonté
pour Nietzsche peut se renverser en volonté de puissance affirmative.
Son intention est d’être créatrice, elle détruit les anciennes valeurs
pour en établir de nouvelles. Elle consiste à créer, vouloir le réel tel
qu’il est et non le réel fabriqué à partir de l’illusion religieuse. Sa
meilleure image est celle de Dionysos. La vraie volonté de puissance est
donc liée à la manie. Elle est avant tout cette force impersonnelle
de la psychose qui traverse Nietzsche et qui décide des modifications
substantielles dans l’humeur et dans le corps du penseur.
![]() Il
faut noter que La Volonté de puissance[23]
est le titre du plus grand ouvrage que Nietzsche envisage d’écrire à partir
de 1886. Or l’envahissement progressif de la pulsion de mort et l’effondrement
mental vont empêcher une construction synthétique de l’œuvre. Dans
le réel cela signifie un échec du concept de la volonté de puissance et
de son désir de transvaluation de la mélancolie.
Il
faut noter que La Volonté de puissance[23]
est le titre du plus grand ouvrage que Nietzsche envisage d’écrire à partir
de 1886. Or l’envahissement progressif de la pulsion de mort et l’effondrement
mental vont empêcher une construction synthétique de l’œuvre. Dans
le réel cela signifie un échec du concept de la volonté de puissance et
de son désir de transvaluation de la mélancolie.
![]() Le concept de volonté
de puissance est d’emblée lié à une mésinterprétation de la question du
désir, ce ratage en soi résume d’ores et déjà toute l’essence de sa psychose.
Le concept de volonté
de puissance est d’emblée lié à une mésinterprétation de la question du
désir, ce ratage en soi résume d’ores et déjà toute l’essence de sa psychose.
![]() Cette affirmation
de la volonté de puissance est à mettre en rapport avec l'aggravation
de la désolation dans la vie de Nietzsche. Dans les Dithyrambes
de Dionysos, la dernière œuvre écrite, le philosophe affirme :
« Le désert croît : malheur à celui qui protège les déserts ».
Cette formule de 1888 est la trace d’une brûlure de plus en plus violente
qui aspirait progressivement Nietzsche vers la régression. Ce cri poussé
au cœur du désert n’empêche nullement son extension et dit la vérité de
la volonté de puissance (le désert est l’ombre de la volonté) : elle ne
peut rien contre la cassure extrême du vide de la forclusion hors duquel
le sujet s’est lui-même rejeté. Le vide qu’éprouve Nietzsche n’est pas
le vide dépressif lié à l’objet absent ou lié au manque dans l’autre.
Le désert de Nietzsche est une béance réelle, un trou qui n’est pas transposable
dans le langage ni modifiable par lui. Le philosophe espère par exemple
à chaque ouvrage avoir livré une bataille spirituelle et gagné une victoire
décisive sur sa maladie mais la désillusion est permanente. Le dépassement
est impossible. Les périodes dépressives ne lâchent pas prise et deviennent
de plus en plus oppressives dans le temps. En 1887,
le philosophe compte sur la force de « dépersonnalisation »
que lui procure sa maladie [24]
pour avancer le plus loin possible dans sa propre « mission »
c’est à dire sa propre destruction comme si le rêve du penseur était alors
de s’annuler et de disparaître des noms du langage. On peut dire alors
que sa mission s’accomplit en janvier 1889.
Cette affirmation
de la volonté de puissance est à mettre en rapport avec l'aggravation
de la désolation dans la vie de Nietzsche. Dans les Dithyrambes
de Dionysos, la dernière œuvre écrite, le philosophe affirme :
« Le désert croît : malheur à celui qui protège les déserts ».
Cette formule de 1888 est la trace d’une brûlure de plus en plus violente
qui aspirait progressivement Nietzsche vers la régression. Ce cri poussé
au cœur du désert n’empêche nullement son extension et dit la vérité de
la volonté de puissance (le désert est l’ombre de la volonté) : elle ne
peut rien contre la cassure extrême du vide de la forclusion hors duquel
le sujet s’est lui-même rejeté. Le vide qu’éprouve Nietzsche n’est pas
le vide dépressif lié à l’objet absent ou lié au manque dans l’autre.
Le désert de Nietzsche est une béance réelle, un trou qui n’est pas transposable
dans le langage ni modifiable par lui. Le philosophe espère par exemple
à chaque ouvrage avoir livré une bataille spirituelle et gagné une victoire
décisive sur sa maladie mais la désillusion est permanente. Le dépassement
est impossible. Les périodes dépressives ne lâchent pas prise et deviennent
de plus en plus oppressives dans le temps. En 1887,
le philosophe compte sur la force de « dépersonnalisation »
que lui procure sa maladie [24]
pour avancer le plus loin possible dans sa propre « mission »
c’est à dire sa propre destruction comme si le rêve du penseur était alors
de s’annuler et de disparaître des noms du langage. On peut dire alors
que sa mission s’accomplit en janvier 1889.
Conclusion
![]() Cet appel à la volonté
pour forcer la mélancolie, combler le vide de la forclusion, lié
à la mésinterprétation de la question du désir, fait écho aux constructions
des grandes idéologies totalitaires du vingtième siècle.
La mort de Dieu [25],
la régression au réel par la destruction de l’illusion de la loi, le forçage
de la loi dans un par-delà le bien et le mal, la transvaluation des valeurs
comme procès de la forclusion, la promotion de la volonté comme ivresse
maniaco-dépressive et comme souci de construire un homme nouveau sur la
destruction du « dernier homme »… ces thèmes croisent les grandes
constructions de la pensée idéologique dans le vingtième siècle et ne
sont pas non plus étrangers au rationalisme scientifique. Nous devons
à Nietzsche, véritable oscillomètre sur le terrain de l’âme, de les avoir
« expérimentés » à partir de la psychose et d’avoir pressenti
leur déchaînement historique à venir.
Cet appel à la volonté
pour forcer la mélancolie, combler le vide de la forclusion, lié
à la mésinterprétation de la question du désir, fait écho aux constructions
des grandes idéologies totalitaires du vingtième siècle.
La mort de Dieu [25],
la régression au réel par la destruction de l’illusion de la loi, le forçage
de la loi dans un par-delà le bien et le mal, la transvaluation des valeurs
comme procès de la forclusion, la promotion de la volonté comme ivresse
maniaco-dépressive et comme souci de construire un homme nouveau sur la
destruction du « dernier homme »… ces thèmes croisent les grandes
constructions de la pensée idéologique dans le vingtième siècle et ne
sont pas non plus étrangers au rationalisme scientifique. Nous devons
à Nietzsche, véritable oscillomètre sur le terrain de l’âme, de les avoir
« expérimentés » à partir de la psychose et d’avoir pressenti
leur déchaînement historique à venir.
Auteur du texte : Philippe Cadiou.
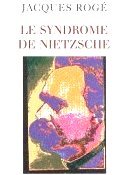 Notes :
Notes :
[1] Le Syndrome de Nietzsche, Jacques
Rogé.
C’est à ce livre que nous empruntons toute la première partie de nos recherches.
Retour en haut
[2] Par exemple, préfaçant les aphorismes des « Notes sur
la maladie », Johan Gok considère que Nietzsche aurait lui-même simulé
sa folie par lassitude. Cette hypothèse nous apparaît impossible. Mort
parce que bête, Editions Parc, 1998. Retour
[3] « J’ai toujours écrit mes œuvres avec tout mon
corps et ma vie. ». Retour
[4] Alain de Bottom, Les Consolations de la philosophie,
Page 252, §21 Edition Mercure de France, 2001, pour la traduction française,
traduit de l’anglais par Jean-Pierre Aoustin. Retour
[5] Janz, Friedrich Nietzsche. Biographie, 1, p.136.
Retour
[6] « On voit à la démarche de quelqu’un s’il a trouvé
sa route, car l’homme qui approche du but ne marche pas, il danse. ».
Retour
[7] Rüdiger Safransky, Nietzsche - Biographie d’une
pensée, page 33, traduit de l’allemand par Nicole Casanova, Acte Sud
2000 pour la traduction française. Retour
[8] Cet épisode n’est cependant attesté par aucun témoignage
à notre connaissance. Retour
[9] Friedrich Nietzsche, Dernières Lettres, lettre du 6
janvier 1889, éditions Rivage/ Petite bibliothèque traduit de l’allemand
par Catherine Perret, P 150, Paris 1989. Retour
[10] Ecce Homo ; Comment on devient ce que l’on
est (1888) écrit dans la foulée de L’Antéchrist, nous
tenons cet ouvrage comme l’un des plus beaux témoignages de la tradition
philosophique dans son ensemble. Retour
[11] Ce sont quelques unes des têtes de chapitre de Ecce
Homo. Retour
[12] Lettre du 26 novembre 1888 à Georg Brandes, Dernières
Lettres, page 97. Retour
[13] On voit bien que la récupération de Nietzsche par
l’Allemagne conservatrice de l’entre-deux guerres est illusoire. Retour
[14] Lettre du 26 novembre 1888 à Georg Brandes. Retour
[15] Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, Œuvres
coll. BOUQUIN, t2, page 1198. Retour
[16] La psychose ordinaire la convention d’Antibes, Le
Paon, collection publiée par Jacques-Alain Miller. Agalma éditeur diffusion
le seuil, 1999. Retour
[17] Ecce Homo, Pourquoi je suis si malin,
Friedrich Nietzsche, coll. Bouquins, Robert Laffont, p 1117, Paris 1993,
traduction Henri Albert. Retour
[18] Idem. Retour
[19] De ce fait, Nietzsche considère qu’il a toujours
eu « un pied hors de la vie », et c’est un héritage de son père toujours
décrit comme un être innocent (un ange !) et exceptionnel auquel il manquait
« l’affirmation de la vie », c’est à dire encore Dionysos, la grande élaboration
du philosophe. Retour
[20] « Ma pratique de l’Allemand est ce qui, à la fin,
m’exile.» Dans le franchissement des frontières géographiques se joue
aussi pour le philosophe le franchissement des frontières de la langue
allemande vers la langue française. Retour
[21] Ecce Homo, Pourquoi je suis si sage,
3. Retour
[22] Nietzsche a désiré plusieurs le mariage mais de façon
très formelle et conformiste. Il était capable de faire une demande en
mariage quelques heureuses après une rencontre. Retour
[23] La volonté de puissance. Essai d’une inversion
de toutes les valeurs. Retour
[24] Friedrich Nietzsche, Dernières Lettres, éditions
Rivage, page 44. Retour
[25] « Déchirer Dieu dans l’homme » dit Nietzsche dans
les Dithyrambes de Dionysos, le poème d’introduction. Retour


