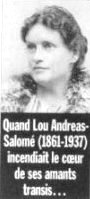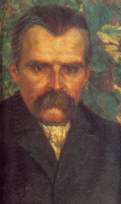Nietzsche vu par ses contemporains
- Curt P. Janz a vécu 15 ans
avec Nietzsche, «parcourant en un an ce que lui-même vivait en deux».
Il répond à un journaliste qui lui demande quelle est l'appréciation
qu'il porte sur la personne de Nietzsche.
 «Je garde l'image d'une
figure tragique. Et d'abord à cause des terribles
maladies, des souffrances impossibles qui
l'ont accompagné sa vie durant et avec lesquelles il lui a fallu constamment
se débattre. Il pensait que cela tenait au climat : alors il cherchait
indéfiniment l'endroit où il serait le mieux. Sa vie a été particulièrement
pénible.
«Je garde l'image d'une
figure tragique. Et d'abord à cause des terribles
maladies, des souffrances impossibles qui
l'ont accompagné sa vie durant et avec lesquelles il lui a fallu constamment
se débattre. Il pensait que cela tenait au climat : alors il cherchait
indéfiniment l'endroit où il serait le mieux. Sa vie a été particulièrement
pénible.
 «Sa philosophie est
faite de passions. Ce n'est pas un philosophe
cérébral, de l'entendement, un philosophe de la connaissance détachée
et désincarnée. Chez lui, tout vient de l'expérience, de ses émotions.
Sa philosophie est débat avec lui-même, avec le christianisme et les interprètes
du christianisme. Je garde une grande considération pour cette vie. Nietzsche
a pensé qu'il avait une mission - il ne nous appartient pas d'en juger
; Il a vécu, totalement, pour elle.
«Sa philosophie est
faite de passions. Ce n'est pas un philosophe
cérébral, de l'entendement, un philosophe de la connaissance détachée
et désincarnée. Chez lui, tout vient de l'expérience, de ses émotions.
Sa philosophie est débat avec lui-même, avec le christianisme et les interprètes
du christianisme. Je garde une grande considération pour cette vie. Nietzsche
a pensé qu'il avait une mission - il ne nous appartient pas d'en juger
; Il a vécu, totalement, pour elle.
 «Il était de compagnie
très agréable ; il parlait doucement. Il était très calme, très amical,
en particulier avec les femmes. Il était toujours bien mis, il se parfumait.
Mais ce n'était pas un homme joyeux. Il fut très apprécié par la société
bâloise, et par des étudiants. Pratiquement, il vécut dans une très grande
solitude, jusqu'à devenir presque étranger aux hommes - c'est une autre
dimension de cette figure tragique - bien qu'il ait constamment cherché,
vainement, des amis, des occasions de conversations. Il s'en est souvent
plaint. Il a aussi cherché des contacts épistolaires.»
«Il était de compagnie
très agréable ; il parlait doucement. Il était très calme, très amical,
en particulier avec les femmes. Il était toujours bien mis, il se parfumait.
Mais ce n'était pas un homme joyeux. Il fut très apprécié par la société
bâloise, et par des étudiants. Pratiquement, il vécut dans une très grande
solitude, jusqu'à devenir presque étranger aux hommes - c'est une autre
dimension de cette figure tragique - bien qu'il ait constamment cherché,
vainement, des amis, des occasions de conversations. Il s'en est souvent
plaint. Il a aussi cherché des contacts épistolaires.»
 Comment la philosophie
de Nietzsche fut-elle reçue de son vivant ?
Comment la philosophie
de Nietzsche fut-elle reçue de son vivant ?
- De son vivant, Nietzsche est resté pratiquement inconnu. Après la publication
de « La Naissance de la tragédie » par exemple, il a dû affronter, à travers
la plume de Wilamowitz, l'establishment philologique ; L'année suivante,
il n'avait plus d'étudiant. Il faut préciser qu'à l'époque l'université
de Bâle tout entière ne comprenait pas plus de deux cents étudiants et
que le séminaire de Nietzsche comprenait « normalement » trois étudiants.
 A la fin de sa carrière, il aura jusqu'à
dix étudiants. Sa reconnaissance a commencé après l'«effondrement», dans
les années 90. L' «effondrement» a certainement eu une importance positive
pour sa popularité, sa valorisation, à l'instar de la mort de Socrate
ou de la mort du Christ. Cela sonnait comme un miracle. C'est sa fin tragique
qui a rendu Nietzsche intéressant pour le public, dans des cercles d'amis,
dans le cercle des wagnériens et jusque dans l'université. Il y aura bien
sûr le travail effectué par sa sœur Élisabeth ; la création
du Nietzsche Archiv à Weimar, en opposition explicite au Goethe Archiv,
toute la mythologie qu'elle s'est efforcée d'édifier autour de son frère
en en faisant un auteur absolument original, qui aurait tout tiré de lui-même,
indépendamment de toute influence.»
A la fin de sa carrière, il aura jusqu'à
dix étudiants. Sa reconnaissance a commencé après l'«effondrement», dans
les années 90. L' «effondrement» a certainement eu une importance positive
pour sa popularité, sa valorisation, à l'instar de la mort de Socrate
ou de la mort du Christ. Cela sonnait comme un miracle. C'est sa fin tragique
qui a rendu Nietzsche intéressant pour le public, dans des cercles d'amis,
dans le cercle des wagnériens et jusque dans l'université. Il y aura bien
sûr le travail effectué par sa sœur Élisabeth ; la création
du Nietzsche Archiv à Weimar, en opposition explicite au Goethe Archiv,
toute la mythologie qu'elle s'est efforcée d'édifier autour de son frère
en en faisant un auteur absolument original, qui aurait tout tiré de lui-même,
indépendamment de toute influence.»
© Interview parue dans le Magazine littéraire (n° 298 - avril
1992)
"Je suis une chose, mon œuvre en est une autre"
Lou Andréas-Salomé
a écrit beaucoup sur sa personnalité : «Ce qui vous fascinait
le plus en lui, c'était ce je ne sais quoi de constamment dérobé
aux regards, mais qui vous frappait, cependant, dès le premier
coup d'œil : le tourment d'une solitude fièrement inavouée.(...)
 « Cet homme de taille
moyenne, très calme et aux cheveux bruns rejetés en arrière, vêtu d'une
façon modeste bien qu'extrêmement soignée, pouvait aisément passer inaperçu.
Les traits fins et merveilleusement expressifs de sa bouche étaient presque
entièrement recouverts par les broussailles d'une épaisse moustache tombante.
Son rire était léger, et jamais il n'élevait la voix en parlant.(...)
« Cet homme de taille
moyenne, très calme et aux cheveux bruns rejetés en arrière, vêtu d'une
façon modeste bien qu'extrêmement soignée, pouvait aisément passer inaperçu.
Les traits fins et merveilleusement expressifs de sa bouche étaient presque
entièrement recouverts par les broussailles d'une épaisse moustache tombante.
Son rire était léger, et jamais il n'élevait la voix en parlant.(...)
 « Ses gestes, et, d'une
façon générale, tout son maintien, donnaient eux aussi, une impression
de silence et de réserve. Il ne se départait jamais d'une grande courtoisie
et d'une douceur presque féminine ; il prenait plaisir aux formes raffinées
et élégantes de la vie, et il ne cessa de leur attacher une importance
considérable. Mais la joie qu'il y puisait venait de ce qu'elles étaient,
pour lui, une sorte de déguisement, un masque servant à recouvrir une
vie intérieure qu'il s'efforçait de ne jamais laisser transparaître. (...)
« Ses gestes, et, d'une
façon générale, tout son maintien, donnaient eux aussi, une impression
de silence et de réserve. Il ne se départait jamais d'une grande courtoisie
et d'une douceur presque féminine ; il prenait plaisir aux formes raffinées
et élégantes de la vie, et il ne cessa de leur attacher une importance
considérable. Mais la joie qu'il y puisait venait de ce qu'elles étaient,
pour lui, une sorte de déguisement, un masque servant à recouvrir une
vie intérieure qu'il s'efforçait de ne jamais laisser transparaître. (...)
 « Sa politesse extérieure
n'était que l'envers de sa solitude intérieure, - cette solitude à la
lumière de laquelle il importe de saisir toute la vie spirituelle de Nietzsche,
et qu'il ne cessa d'accroître autour de lui, comme pour s'obliger toujours
plus, à tout tirer de lui-même.»
« Sa politesse extérieure
n'était que l'envers de sa solitude intérieure, - cette solitude à la
lumière de laquelle il importe de saisir toute la vie spirituelle de Nietzsche,
et qu'il ne cessa d'accroître autour de lui, comme pour s'obliger toujours
plus, à tout tirer de lui-même.»
(Frédéric Nietzsche © B. Grasset, 1932, Réimpressions
Gordon & Breach)
![]() Ainsi, son comportement
ne correspondait pas avec son œuvre. Mais pourquoi écrivait-il
?
Ainsi, son comportement
ne correspondait pas avec son œuvre. Mais pourquoi écrivait-il
?
A ce propos, Nietzsche considère qu'il n'a fait qu'enlever de lui
ce qui l'importunait (Aurore, Livre IV § 463). Ce qui
est confirmé dans ce petit dialogue du Gai savoir,
qui résonne comme un aveu :
« Ecrire est pour moi comme faire mes besoins ».
- Mais pourquoi écris-tu donc ?
- Hélas ! mon cher, sois dit entre nous, je n'ai pas encore trouvé
d'autre moyen de me débarrasser de mes pensées.
- Et pourquoi veux-tu te débarrasser de tes pensées ?
- Pourquoi je veux ? Est-ce que je veux, seulement ? J'y suis forcé.
- Bon ! bon !
(Gai Savoir, Livre 2, § 93 )
Carl Paul Janz est l'auteur d'une biographie monumentale
de Nietzsche, parue en 1978 en Allemagne, trois volumes dans l'édition
française pourtant quelque peu abrégée, biographie qui peut paraître pratiquement
définitive. Elle a connu plusieurs éditions allemandes (chez Hanser Verlag),
des versions italienne, espagnole et française (chez Gallimard, 1984).
![]()