Principaux schismes et conciles
 On dénombre une cinquantaine de
conciles apostoliques, et presque autant de schismes, - les deux sont
liés.
On dénombre une cinquantaine de
conciles apostoliques, et presque autant de schismes, - les deux sont
liés.
![]() Concile de Jérusalem
(47 ou 49 ap. J.-C.) La première controverse aboutit au schisme
qui oppose Saül aux apôtres Juifs au sujet de la foi, et de
la Loi. Le livre des Actes (ch. XV) semble adoucir le débat qui
est l'objet des épîtres. Bien qu'ignoré par l'Eglise,
ce premier schisme est sans doute le plus important de l'histoire du christianisme
au vu des avertissements et polémiques dont les diverses épîtres
abondent : Saul y est traité d'adversaire, d'apostat, et d'imposteur,
bien qu'il s'en défende.
Concile de Jérusalem
(47 ou 49 ap. J.-C.) La première controverse aboutit au schisme
qui oppose Saül aux apôtres Juifs au sujet de la foi, et de
la Loi. Le livre des Actes (ch. XV) semble adoucir le débat qui
est l'objet des épîtres. Bien qu'ignoré par l'Eglise,
ce premier schisme est sans doute le plus important de l'histoire du christianisme
au vu des avertissements et polémiques dont les diverses épîtres
abondent : Saul y est traité d'adversaire, d'apostat, et d'imposteur,
bien qu'il s'en défende.
 Dans le Temple de Jérusalem,
Saul est assailli par la foule des Juifs qui l'interpellent : «Le
voici l'individu qui prêche à tous et partout contre notre
peuple, contre la Loi et contre ce lieu.» (Actes XXI, 28) La foule
qui a reçu Jésus en triomphe à Jérusalem et
qui se souvient que Jésus respectait la Loi et n'admettait pas
qu'un iota y soit ôté dénonce ce prévaricateur
!
Dans le Temple de Jérusalem,
Saul est assailli par la foule des Juifs qui l'interpellent : «Le
voici l'individu qui prêche à tous et partout contre notre
peuple, contre la Loi et contre ce lieu.» (Actes XXI, 28) La foule
qui a reçu Jésus en triomphe à Jérusalem et
qui se souvient que Jésus respectait la Loi et n'admettait pas
qu'un iota y soit ôté dénonce ce prévaricateur
!
 Saul deviendra pourtant St Paul,
le premier à faire de Jésus "l'égal de Dieu",
de la croix un emblème, et du Christ un principe mystique. Son
évangile diffère de celui des apôtres. Les «pauvres»
(ébionites) et les Nazaréens niaient la divinité
de Jésus. Absurde le titre de «fils unique» de Dieu
? C'était tout simplement un titre qu'avaient adopté les
successeurs du trône de David. Il a fallu attendre quarante ans
après la mort du Christ pour que commence l'écriture des
épitres de Paul, puis encore un certain temps pour les premiers
Evangiles, en langue grecque, tout à la fin du Ier siècle
de notre ère. Loin d'imaginer la naissance d'une nouvelle religion
du salut, les disciples de Jésus, d'ailleurs illettrés,
n'avaient pas pensé consigner par écrit la vie de leur maître.
C'est donc après la venue de Saint Paul et de ses disciples que
tout a changé et que les écrits chrétiens sont apparus.
Dès le début, les querelles religieuses ont agité
le monde judéo-chrétien, et les diverses églises
n'étaient pas encore sous la coupe de Rome. Apparu au Moyen-Orient,
la doctrine de Mani, le manichéisme
se répand dans tout l'Empire malgré les persécutions
dont il est l'objet. Le second schisme se profile au IVe siècle
sous l'Empereur romain Constantin le Grand, qui fit du christianisme la
religion d'Etat.
Saul deviendra pourtant St Paul,
le premier à faire de Jésus "l'égal de Dieu",
de la croix un emblème, et du Christ un principe mystique. Son
évangile diffère de celui des apôtres. Les «pauvres»
(ébionites) et les Nazaréens niaient la divinité
de Jésus. Absurde le titre de «fils unique» de Dieu
? C'était tout simplement un titre qu'avaient adopté les
successeurs du trône de David. Il a fallu attendre quarante ans
après la mort du Christ pour que commence l'écriture des
épitres de Paul, puis encore un certain temps pour les premiers
Evangiles, en langue grecque, tout à la fin du Ier siècle
de notre ère. Loin d'imaginer la naissance d'une nouvelle religion
du salut, les disciples de Jésus, d'ailleurs illettrés,
n'avaient pas pensé consigner par écrit la vie de leur maître.
C'est donc après la venue de Saint Paul et de ses disciples que
tout a changé et que les écrits chrétiens sont apparus.
Dès le début, les querelles religieuses ont agité
le monde judéo-chrétien, et les diverses églises
n'étaient pas encore sous la coupe de Rome. Apparu au Moyen-Orient,
la doctrine de Mani, le manichéisme
se répand dans tout l'Empire malgré les persécutions
dont il est l'objet. Le second schisme se profile au IVe siècle
sous l'Empereur romain Constantin le Grand, qui fit du christianisme la
religion d'Etat.
![]() Concile de Nicée
I (325) Premier concile œcuménique, convoqué par
l'Empereur qui est le Grand Pontife, non par
l'évêque de Rome (simple ministre élu par les fidèles
jusqu'en 872), à cause des controverses qui déchirent les
communautés chrétiennes créant des troubles dans
l'Empire. L'Eglise de Rome impose sa profession de foi avec le soutien
inattendu de l'Empereur. Le credo, abusivement appelé "symbole
des apôtres", est formulé. On y décida de la
grande question qui agitait l’Église touchant la divinité
de Jésus-Christ : le Fils fusionne avec le Père. Parmi les
différentes doctrines et les controverses, nombreuses à
l'époque, celle d'Arius, qui rejette l'idée de consubstantialité
et d'identité Père-Fils ou Dieu-Christ, est combattue et
rejetée comme hérésie... Mais les tenants de l'arianisme
s'obstinèrent et le schisme devint inéluctable. La Bible
chrétienne la plus ancienne, le Codex
sinaiticus, n'a été transcrite qu'entre 330 et 350,
dans le sanctuaire du Sinaï. Les disciples d'Arius tinrent un concile
à Constantinople en 360, obligeant Rome à devenir plus ferme contre
ce qu'elle nomme une "hérésie".
Concile de Nicée
I (325) Premier concile œcuménique, convoqué par
l'Empereur qui est le Grand Pontife, non par
l'évêque de Rome (simple ministre élu par les fidèles
jusqu'en 872), à cause des controverses qui déchirent les
communautés chrétiennes créant des troubles dans
l'Empire. L'Eglise de Rome impose sa profession de foi avec le soutien
inattendu de l'Empereur. Le credo, abusivement appelé "symbole
des apôtres", est formulé. On y décida de la
grande question qui agitait l’Église touchant la divinité
de Jésus-Christ : le Fils fusionne avec le Père. Parmi les
différentes doctrines et les controverses, nombreuses à
l'époque, celle d'Arius, qui rejette l'idée de consubstantialité
et d'identité Père-Fils ou Dieu-Christ, est combattue et
rejetée comme hérésie... Mais les tenants de l'arianisme
s'obstinèrent et le schisme devint inéluctable. La Bible
chrétienne la plus ancienne, le Codex
sinaiticus, n'a été transcrite qu'entre 330 et 350,
dans le sanctuaire du Sinaï. Les disciples d'Arius tinrent un concile
à Constantinople en 360, obligeant Rome à devenir plus ferme contre
ce qu'elle nomme une "hérésie".
![]() Le concile de Constantinople
I (381) clôt, entre autres, cette affaire. C'est en réalité
un schisme éliminant tous les chrétiens opposés
aux doctrines romaines, évêques compris. L'Esprit Saint devient
la 3ième personne de la très sainte Trinité.
La primauté papale de Rome s'établit peu à peu.
Le concile de Constantinople
I (381) clôt, entre autres, cette affaire. C'est en réalité
un schisme éliminant tous les chrétiens opposés
aux doctrines romaines, évêques compris. L'Esprit Saint devient
la 3ième personne de la très sainte Trinité.
La primauté papale de Rome s'établit peu à peu.
 Les manuscrits originaux existaient encore
en partie et les premiers conciles consistaient à remettre de l'ordre
dans la chrétienté et à affirmer la primauté
de l'évêque de Rome. En 385, la version latine du Nouveau
Testament fut écrite sous la supervision de St Jérôme.
C'est à ce moment que l'on tranche en éliminant du canon
tout les autres textes (une vingtaine de textes apocryphes ont échappé
à la censure ou aux flammes). La Bible juive ou Ancien Testament
est alors entièrement révisée et en 405, la Vulgate
sort au complet ("Testament" vient de l'épître
aux Hébreux, anonyme, mais attribuée à Paul). L'empereur
Théodose interdit tous les cultes païens en 391. Les années
noires de l'Église vont continuer jusque sous l'empereur Justinien
(482-565). Sa reconquête de l'Italie le rend maître de Rome,
d'où le pape Silvère est déposé, puis exilé
(537).
Les manuscrits originaux existaient encore
en partie et les premiers conciles consistaient à remettre de l'ordre
dans la chrétienté et à affirmer la primauté
de l'évêque de Rome. En 385, la version latine du Nouveau
Testament fut écrite sous la supervision de St Jérôme.
C'est à ce moment que l'on tranche en éliminant du canon
tout les autres textes (une vingtaine de textes apocryphes ont échappé
à la censure ou aux flammes). La Bible juive ou Ancien Testament
est alors entièrement révisée et en 405, la Vulgate
sort au complet ("Testament" vient de l'épître
aux Hébreux, anonyme, mais attribuée à Paul). L'empereur
Théodose interdit tous les cultes païens en 391. Les années
noires de l'Église vont continuer jusque sous l'empereur Justinien
(482-565). Sa reconquête de l'Italie le rend maître de Rome,
d'où le pape Silvère est déposé, puis exilé
(537).
![]() Concile d'Ephèse
(431). Il affirme la double nature de Jésus-Christ : divin fils
de Dieu et homme né d'une mortelle, Marie,
laquelle est alors proclamée “mère de Dieu”,
et condamne Nestorius qui nie que Marie soit la "mère de Dieu".
Dieu, s'il est le Père, ne peut avoir une mère qui soit
la mère de son fils ! A moins que... un prêtre aurait fait
un fils de Dieu avec une mortelle encore vierge (prostituée sacrée).
Le culte marial remplace le culte antique de la grand déesse, Arthémis
pour les Ephésiens.
Concile d'Ephèse
(431). Il affirme la double nature de Jésus-Christ : divin fils
de Dieu et homme né d'une mortelle, Marie,
laquelle est alors proclamée “mère de Dieu”,
et condamne Nestorius qui nie que Marie soit la "mère de Dieu".
Dieu, s'il est le Père, ne peut avoir une mère qui soit
la mère de son fils ! A moins que... un prêtre aurait fait
un fils de Dieu avec une mortelle encore vierge (prostituée sacrée).
Le culte marial remplace le culte antique de la grand déesse, Arthémis
pour les Ephésiens.
![]() Le concile de Calcédoine
(451) Il règle les dissidences des Coptes, Éthiopiens, Arméniens
et Syriens. Plus on se querelle sur ces questions théologiques
et plus on dogmatise. Proclamation de Marie "Vierge à jamais" (comme
l'était auparavant Isis et bien d'autres déesses). Il n'était
pas question que Marie aie commis le péché de la chair...
Voyons ! Avec Sainte Marie, Dieu en 3 personnes et tous les Saints, on
ne sait bientôt plus à qui prier. Curieux monothéisme
! La Vierge réapparaîtra bien plus tard en divers lieux,
et personne ne s'apercevra de la supercherie.
Le concile de Calcédoine
(451) Il règle les dissidences des Coptes, Éthiopiens, Arméniens
et Syriens. Plus on se querelle sur ces questions théologiques
et plus on dogmatise. Proclamation de Marie "Vierge à jamais" (comme
l'était auparavant Isis et bien d'autres déesses). Il n'était
pas question que Marie aie commis le péché de la chair...
Voyons ! Avec Sainte Marie, Dieu en 3 personnes et tous les Saints, on
ne sait bientôt plus à qui prier. Curieux monothéisme
! La Vierge réapparaîtra bien plus tard en divers lieux,
et personne ne s'apercevra de la supercherie.
![]() Le concile de
Constantinople II (553) condamne Origène et l'origénisme
qui est la doctrine très répandue qu'il professait, avec
tous les Pères de l'Église grecque, d'Athènes à
Alexandrie : la réincarnation. L'initiative vient de l'empereur
Justinien et non du Pape Vigile. Digne des fameuses querelles byzantines,
il marque le début d'un schisme avec les orthodoxes !
Le concile de
Constantinople II (553) condamne Origène et l'origénisme
qui est la doctrine très répandue qu'il professait, avec
tous les Pères de l'Église grecque, d'Athènes à
Alexandrie : la réincarnation. L'initiative vient de l'empereur
Justinien et non du Pape Vigile. Digne des fameuses querelles byzantines,
il marque le début d'un schisme avec les orthodoxes !
![]() Le concile de Constantinople
III condamne le monothélisme (680) de Sergius. Une querelle byzantine
de plus est ainsi éliminée.
Le concile de Constantinople
III condamne le monothélisme (680) de Sergius. Une querelle byzantine
de plus est ainsi éliminée.
![]() Le concile de Nicée
II (787) condamne les iconoclastes. Charlemagne va s'en mêler et
provoquer la querelle du filioque : nouveau schisme en vue.
Le concile de Nicée
II (787) condamne les iconoclastes. Charlemagne va s'en mêler et
provoquer la querelle du filioque : nouveau schisme en vue.
![]() Concile de Constantinople
IV (869-877), décide que l'homme est constitué seulement
d'un corps et d'une âme (alors que depuis la plus lointaine antiquité
égyptienne, c'était la conception tripartite corps-âme-esprit
qui prévalait). C'est aussi là où il est débattu
de la primauté de l'Église de Rome. Tous ces conciles se
passent en pleine période byzantine, et l'histoire de cet empire
bizantin est truffé de preuves que c'est le pouvoir qui s'appuie
sur la religion pour dominer. Mais quand deux pouvoirs s'affrontent cela
donne un nouveau schisme, celui entre l'empire d'orient, l'orthodoxe,
et l'empire d'occident, celui qui se veut catholique.
Concile de Constantinople
IV (869-877), décide que l'homme est constitué seulement
d'un corps et d'une âme (alors que depuis la plus lointaine antiquité
égyptienne, c'était la conception tripartite corps-âme-esprit
qui prévalait). C'est aussi là où il est débattu
de la primauté de l'Église de Rome. Tous ces conciles se
passent en pleine période byzantine, et l'histoire de cet empire
bizantin est truffé de preuves que c'est le pouvoir qui s'appuie
sur la religion pour dominer. Mais quand deux pouvoirs s'affrontent cela
donne un nouveau schisme, celui entre l'empire d'orient, l'orthodoxe,
et l'empire d'occident, celui qui se veut catholique.
![]() Le schisme d'Orient
(1054-1453) La rupture entre Rome et Constantinople s'est faite progressivement,
rupture qui devient définitive en 1453 avec la conquête de la ville par
les Turcs après le sac barbare de Constantinople par les Croisés.
En fait, la controverse du filio que avait commencé avec l'Empereur
Charlemagne qui tenait beaucoup à ajouter ce mot au credo. La suprématie
du Père disparaît, et sans cette hiérarchie, le contenu
métaphysique est détruit.
Le schisme d'Orient
(1054-1453) La rupture entre Rome et Constantinople s'est faite progressivement,
rupture qui devient définitive en 1453 avec la conquête de la ville par
les Turcs après le sac barbare de Constantinople par les Croisés.
En fait, la controverse du filio que avait commencé avec l'Empereur
Charlemagne qui tenait beaucoup à ajouter ce mot au credo. La suprématie
du Père disparaît, et sans cette hiérarchie, le contenu
métaphysique est détruit.

 Entre
le schisme d'Orient et le grand schisme d'Occident, outre que l'un conserve
l'orthodoxie et l'autre veut prétendre à l'universalité
ou catholicisme, il se passe beaucoup de choses:
Entre
le schisme d'Orient et le grand schisme d'Occident, outre que l'un conserve
l'orthodoxie et l'autre veut prétendre à l'universalité
ou catholicisme, il se passe beaucoup de choses:
- D'abord, les croisades pour les lieux saints, pour relancer la foi qui
faiblit partout. On rapporte des soi-disant reliques. Début du
culte des reliques des Saints : pur fétichisme !
- Trafic de fausses reliques, et, belle imposture : trafic des indulgences
papales pour financer la reconstruction de l'immense basilique St Pierre
de Rome...
- En France, les croisades contre les Cathares, Albigeois... Béziers,
Carcassonne, Toulouse : le clergé encourage des guerres sanglantes
contre ceux qui sont considérés "hérétiques".
- Le pape ordonne la destitution des Templiers,
ordre de moine soldats, après un procès inique.
![]() Concile de Latran I
(1123): finalement, la papauté obtient gain de cause dans la querelle
des investitures papales et devient une puissance politique indépendante,
une véritable monarchie théocratique. Elle gouverne les
âmes en Europe.
Concile de Latran I
(1123): finalement, la papauté obtient gain de cause dans la querelle
des investitures papales et devient une puissance politique indépendante,
une véritable monarchie théocratique. Elle gouverne les
âmes en Europe.
![]() Cela n'empêche
pas un nouveau schisme en 1130 : le Sacré Collège se divise
et les cardinaux élisent deux papes qui s'opposent pendant 8 ans
(Papes
et Antipapes).
Cela n'empêche
pas un nouveau schisme en 1130 : le Sacré Collège se divise
et les cardinaux élisent deux papes qui s'opposent pendant 8 ans
(Papes
et Antipapes).
![]() Concile de Latran II
(1139): tente de faire cesser la simonie, condamne l'usure, prêche
la continence des clercs. Tous sont soumis à l'autorité
du pape qui se réserve le droit de juger et de s'octroyer des bénéfices
particuliers. Marie est proclamée perpétuellement vierge
Concile de Latran II
(1139): tente de faire cesser la simonie, condamne l'usure, prêche
la continence des clercs. Tous sont soumis à l'autorité
du pape qui se réserve le droit de juger et de s'octroyer des bénéfices
particuliers. Marie est proclamée perpétuellement vierge
![]() Concile de Latran III
(1179): L'autorité législative suprême du pape est
exprimé par décret. Il condamne les Albigeois et les Vaudois
d'hérésie alors que la curie romaine est elle-même
accusée de corruption et d'avarice. Il fait chasser une bande de
faux-monayeurs qui opéraient à la chancellerie papale.
Concile de Latran III
(1179): L'autorité législative suprême du pape est
exprimé par décret. Il condamne les Albigeois et les Vaudois
d'hérésie alors que la curie romaine est elle-même
accusée de corruption et d'avarice. Il fait chasser une bande de
faux-monayeurs qui opéraient à la chancellerie papale.
![]() Concile de Latran IV
(1215). La consécration du pain et du vin en font le corps et le
sang du Christ, comme par magie. Le Pape va combattre le "paganisme" et
les "hérésies" en centralisant son pouvoir et en tentant
de supprimer les abus qui sont reprochés au haut clergé.
Au concile de Latran IV, institution de l'Inquisition
avec Innocent III, après l'introduction de la torture par le
pape Innocent I.Début des croisades meurtières contre les
hérétiques (Albigeois).
Concile de Latran IV
(1215). La consécration du pain et du vin en font le corps et le
sang du Christ, comme par magie. Le Pape va combattre le "paganisme" et
les "hérésies" en centralisant son pouvoir et en tentant
de supprimer les abus qui sont reprochés au haut clergé.
Au concile de Latran IV, institution de l'Inquisition
avec Innocent III, après l'introduction de la torture par le
pape Innocent I.Début des croisades meurtières contre les
hérétiques (Albigeois).
![]() Le premier Concile de Lyon (1245).
Les choses ont changé et les questions politiques priment
(conflit avec Frédéric II, dangers venant d'Orient, événements malheureux
en Terre Sainte ). Mais l'autorité du Pape s'est affaiblie et on lui reproche de s'enrichir
en prélevant trop d'impôts.
Le premier Concile de Lyon (1245).
Les choses ont changé et les questions politiques priment
(conflit avec Frédéric II, dangers venant d'Orient, événements malheureux
en Terre Sainte ). Mais l'autorité du Pape s'est affaiblie et on lui reproche de s'enrichir
en prélevant trop d'impôts.
Le second Concile de Lyon (1274) n'est qu'une demi-étape et on attend encore tout de
Grégoire X.
![]() Concile de Vienne (1311). C'est la plus grave crise qu'aie
connu la papauté, qui, attaquée par ses évêques pour son pouvoir
absolu sur tout le clergé et dominée par Philippe le Bel qui veut la dissolution de
l'Ordre du Temple pour récupérer ses biens, fit grise mine.
Concile de Vienne (1311). C'est la plus grave crise qu'aie
connu la papauté, qui, attaquée par ses évêques pour son pouvoir
absolu sur tout le clergé et dominée par Philippe le Bel qui veut la dissolution de
l'Ordre du Temple pour récupérer ses biens, fit grise mine.
![]() Le grand schisme d'Occident (1378-1417).
Le grand schisme d'Occident (1378-1417).
L'épisode des papes à Avignon (1309-77) inaugure une grave crise dans
la hiérarchie de l'Église. A cause d'innombrables abus de
pouvoir, népotisme, corruption, la papauté fut inévitablement
en butte à la critique et l'Église devint un corps divisé.
La situation a plutôt empiré, avec les papes à Avignon...
On voit simultanément jusqu'à trois papes rivaux. Dorénavant,
les prêtres doivent faire vœux de chasteté !
 Le grand schisme est consommé avec
la mise à sac de Constantinople par les croisés. Les principaux
conciles suivants marquent les étapes des rapports entre la Curie
romaine et les Souverains car une partie du clergé est attachée
au roi. Commencement d'une nouvelle querelle.
Le grand schisme est consommé avec
la mise à sac de Constantinople par les croisés. Les principaux
conciles suivants marquent les étapes des rapports entre la Curie
romaine et les Souverains car une partie du clergé est attachée
au roi. Commencement d'une nouvelle querelle.
![]() Concile de Pise (1409):
les deux papes antagonistes sont déposés. Un 3ième pape est élu.
Concile de Pise (1409):
les deux papes antagonistes sont déposés. Un 3ième pape est élu.
![]() Concile de Constance (1414-17). C'est le
16e concile et rien n'a changé, car les abus et doléances se sont multipliés.
L'Église est incapable de se réformer.
Avec trois papes plus attachés à leur tiare qu'à l'unité de L'Église,
qui furent finalement contraints de la céder au profit d'un quatrième, Martin V, les
sessions se succédèrent sans aboutir à une conclusion. Le luxe et la prodigalité de la cour papale était proverbiale...
On n'en finit pas de vaticiner, et de juger la proposition de Wiclef
comme hérétique, et de condamner au bûcher. Venus y assister en personnes,
Jean Huss et Jérôme de Prague sont condamnés à être brûlés vifs !!!
Concile de Constance (1414-17). C'est le
16e concile et rien n'a changé, car les abus et doléances se sont multipliés.
L'Église est incapable de se réformer.
Avec trois papes plus attachés à leur tiare qu'à l'unité de L'Église,
qui furent finalement contraints de la céder au profit d'un quatrième, Martin V, les
sessions se succédèrent sans aboutir à une conclusion. Le luxe et la prodigalité de la cour papale était proverbiale...
On n'en finit pas de vaticiner, et de juger la proposition de Wiclef
comme hérétique, et de condamner au bûcher. Venus y assister en personnes,
Jean Huss et Jérôme de Prague sont condamnés à être brûlés vifs !!!
![]() Concile de Bâle (1431)
rattaché aux deux conciles précédents, dénommés
Concile cuménique de Pise, Constance et Bâle.
Concile de Bâle (1431)
rattaché aux deux conciles précédents, dénommés
Concile cuménique de Pise, Constance et Bâle.
![]() Concile de Florence (1440): essai de rapprochement avec
les Grecs; mais sans succès. La rupture avec les Églises d'Orient dites orthodoxes
est consommée après le sac de Constantinople,
et en Russie en 1589, avec le patriarcat autonome de Moscou.
Concile de Florence (1440): essai de rapprochement avec
les Grecs; mais sans succès. La rupture avec les Églises d'Orient dites orthodoxes
est consommée après le sac de Constantinople,
et en Russie en 1589, avec le patriarcat autonome de Moscou.
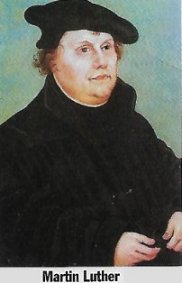
![]() La Réforme. Martin Luther, ce moine et théologien
force l'Eglise à se réformer.
La Réforme. Martin Luther, ce moine et théologien
force l'Eglise à se réformer.
Dénonçant les "indulgences papales", Luther nie
la primauté du siège romain; il invective contre les vux
et le célibat des prêtres, met en avant son fameux sacerdoce
laïque, détruisant toute la hiérarchie de l'Église.
Auparavant, seul le clergé était autorisé à
interpréter les Écritures. Cela va changer avec les traductions
de la bible qui sera largement diffusée grâce à l'imprimerie.
Le christianisme se divise alors en plusieurs religions, sectes, Églises.
Le culte marial est ce qui oppose idéologiquement Chrétiens
et Protestants, et les disciples de Luther finissent par pousser le clergé
à la contre-réforme de l'Église. En 1533, Calvin
se rallie à la Réforme. Mais le protestantisme met aussi
fin à l'ésotérisme chrétien en rejetant les
sacrements.
![]() Concile de Latran V
(1512-17) Réforme du clergé. Mentionnons la bulle papale,
motivée par la découverte de l'imprimerie, interdisant la
publication d'aucun livre sans approbation ecclésiastique. La Bible
sort des presses. Puis, suite à la publication des prédictions
de Nostradamus, "il est interdit de déterminer l'époque
des calamités futures, de la venue de l'antéchrist et du
jugement dernier, et aussi, d'alléguer des révélations
et inspirations particulières." On les distribue alors sous le
manteau.
Concile de Latran V
(1512-17) Réforme du clergé. Mentionnons la bulle papale,
motivée par la découverte de l'imprimerie, interdisant la
publication d'aucun livre sans approbation ecclésiastique. La Bible
sort des presses. Puis, suite à la publication des prédictions
de Nostradamus, "il est interdit de déterminer l'époque
des calamités futures, de la venue de l'antéchrist et du
jugement dernier, et aussi, d'alléguer des révélations
et inspirations particulières." On les distribue alors sous le
manteau.

![]() Nouveaux schismes à la Renaissance :
Nouveaux schismes à la Renaissance :
l'Église Anglicane se constitue en 1534, les Calvinistes se distinguent
des Luthériens et forment une autre secte chrétienne en
1540.
La congrégation des juges de l'inquisition
est fondée en 1542 par le pape Paul III.
![]() Concile de Trente
(1545-1563) : ce concile signe des décrets dogmatiques, notament
sur le péché originel, la justification par la foi, et sur
les sacrements. Sous l'impulsion de la société de Jésus,
les Jésuites vont à la reconquète des classes populaires
et christianisent les indigènes du Nouveau Monde. Ils tiennent
à ce que Marie soit à la fois "reine du ciel",
déesse, vierge, et exonérée du péché
originel : c'est la rupture entre Catholiques et Protestants ! Le recourt
à l'Inquisition reprend de plus bel !
Concile de Trente
(1545-1563) : ce concile signe des décrets dogmatiques, notament
sur le péché originel, la justification par la foi, et sur
les sacrements. Sous l'impulsion de la société de Jésus,
les Jésuites vont à la reconquète des classes populaires
et christianisent les indigènes du Nouveau Monde. Ils tiennent
à ce que Marie soit à la fois "reine du ciel",
déesse, vierge, et exonérée du péché
originel : c'est la rupture entre Catholiques et Protestants ! Le recourt
à l'Inquisition reprend de plus bel !
 En France, la réforme
protestante est tolérée grâce au bon roi Henri IV,
mais l'édit de Nantes (1598) ne stoppe pas les persécutions
(dragonnades) et, en 1685, l'édit est révoqué
par Louis XIV sur les recommandations de son confesseur jésuite,
ce qui relance les persécutions et massacres.
En France, la réforme
protestante est tolérée grâce au bon roi Henri IV,
mais l'édit de Nantes (1598) ne stoppe pas les persécutions
(dragonnades) et, en 1685, l'édit est révoqué
par Louis XIV sur les recommandations de son confesseur jésuite,
ce qui relance les persécutions et massacres.
 C'est en Espagne que l'Inquisition
aura été la plus terrible et la plus longue ; elle ne fut
abolie qu'en 1834. Convoqués en 1869 pour réagir aux attaques
modernes du scientisme, les cardinaux proclament le dogme de l'infaillibilité
pontificale en 1870 (infaillible seulement en matière de théologie
pour que le pape proclame "l'immaculée conception").
C'est sa "vérité" qui pose problème, pourtant.
Voltaire constatait au VXIIIe siècle que les persécutions
contre les Païens, les Juifs, les Protestants et les hérétiques,
furent mille fois plus nombreuses que celles des apôtres par les
autorités juives et des chrétiens par les Romains.
C'est en Espagne que l'Inquisition
aura été la plus terrible et la plus longue ; elle ne fut
abolie qu'en 1834. Convoqués en 1869 pour réagir aux attaques
modernes du scientisme, les cardinaux proclament le dogme de l'infaillibilité
pontificale en 1870 (infaillible seulement en matière de théologie
pour que le pape proclame "l'immaculée conception").
C'est sa "vérité" qui pose problème, pourtant.
Voltaire constatait au VXIIIe siècle que les persécutions
contre les Païens, les Juifs, les Protestants et les hérétiques,
furent mille fois plus nombreuses que celles des apôtres par les
autorités juives et des chrétiens par les Romains.
![]() Conciles du Vatican
(1962-1964 puis 1965). Convoqué par le bon pape Jean XXIII, ce
concile tente une dernière Réforme de l'Église mais
il meurt trop tôt pour cela, et, repris avec Paul VI, le concile
n'aboutit pas à grand chose.
Conciles du Vatican
(1962-1964 puis 1965). Convoqué par le bon pape Jean XXIII, ce
concile tente une dernière Réforme de l'Église mais
il meurt trop tôt pour cela, et, repris avec Paul VI, le concile
n'aboutit pas à grand chose.
 Le pape Jean XXIII a fait publiquement
repentance pour l'Église, mais la repentance de l'Église
se justifie dans la mesure où elle est coupable des choses qu'elle
confesse. Cela signifie donc qu'elle abandonne sa prétendue "infaillibilité".
Amen.
Le pape Jean XXIII a fait publiquement
repentance pour l'Église, mais la repentance de l'Église
se justifie dans la mesure où elle est coupable des choses qu'elle
confesse. Cela signifie donc qu'elle abandonne sa prétendue "infaillibilité".
Amen.
 Conclusions
Conclusions
![]() Ce sont toujours des controverses
qui ont fait réunir les conciles apostoliques. Au début, c'est
autant une question de doctrine que de suprématie romaine.
Ce sont toujours des controverses
qui ont fait réunir les conciles apostoliques. Au début, c'est
autant une question de doctrine que de suprématie romaine.
![]() Ensuite c'est la lutte
contre les hérésies, mais la véritable cause des "hérésies"
ne fut pas une question de doctrine mais une protestation contre l'autorité
de l'Église de Rome, contre les abus de pouvoir du clergé très
hiérarchisé et corrompu, et contre son enrichissement.
Ensuite c'est la lutte
contre les hérésies, mais la véritable cause des "hérésies"
ne fut pas une question de doctrine mais une protestation contre l'autorité
de l'Église de Rome, contre les abus de pouvoir du clergé très
hiérarchisé et corrompu, et contre son enrichissement.
![]() En fait, c'est surtout
Luther qui a obligé l'Église à se réformer (contre-réforme).
L'Église s'est donc continuellement déchirée, mais sa constitution
est telle qu'elle a tenu bon, même dans la tourmente. Elle repose
sur le secret, comme toute conspiration. Et finalement, cela fait combien
de sectes chrétiennes ?
En fait, c'est surtout
Luther qui a obligé l'Église à se réformer (contre-réforme).
L'Église s'est donc continuellement déchirée, mais sa constitution
est telle qu'elle a tenu bon, même dans la tourmente. Elle repose
sur le secret, comme toute conspiration. Et finalement, cela fait combien
de sectes chrétiennes ?
Sur ce sujet, on s'est inspiré de la rubrique “Conciles”
du Dictionnaire Philosophique de Voltaire. Voir aussi note
ci-dessous.
 MITHRAïSME ET MANICHÉISME
EN ORIENT
MITHRAïSME ET MANICHÉISME
EN ORIENT
Oublieux de la prédication de Zoroastre,
le monde iranien fait de Mithra le premier
des dieux, empruntant à Ahura-Mazdâ son caractère
de dieu lumineux et justicier. Répandu dans tout l'Orient, son
culte est adopté par nombre de soldats romains qui l'introduisent
dans le monde méditerranéen, mais il sera ensuite supplanté
par le christianisme.
 Reconnue par les Iraniens depuis
les origines, la lutte du Bien et du Mal devient au IIIe siècle
après J-C., par l'enseignement de Mani, le fondement d'une religion
dualiste, le manichéisme. La lutte éternelle
du Bien et du Mal, dans l'homme comme dans l'Univers, oblige le fidèle
à un ascétisme qui le délivre des désirs du
corps. Ceux qui n'y parviennent pas doivent passer par des réincarnations
jusqu'à l'anéantissement du monde : après 15 siècles
d'embrasement, le Bien sera enfin séparé du Mal. Bien que
persécutée (Mani est exécuté vers 275), cette
hérésie conquiert de nombreux disciples dans l'Empire iranien
des Sassanides, dont les souverains sont zoroastriens.
Reconnue par les Iraniens depuis
les origines, la lutte du Bien et du Mal devient au IIIe siècle
après J-C., par l'enseignement de Mani, le fondement d'une religion
dualiste, le manichéisme. La lutte éternelle
du Bien et du Mal, dans l'homme comme dans l'Univers, oblige le fidèle
à un ascétisme qui le délivre des désirs du
corps. Ceux qui n'y parviennent pas doivent passer par des réincarnations
jusqu'à l'anéantissement du monde : après 15 siècles
d'embrasement, le Bien sera enfin séparé du Mal. Bien que
persécutée (Mani est exécuté vers 275), cette
hérésie conquiert de nombreux disciples dans l'Empire iranien
des Sassanides, dont les souverains sont zoroastriens.
Grand Pontife : Ce titre
pontifex maximus fut transmis par l'héritière
des Pharaons, Cléopâtre, à Octave Auguste et à
ses successeurs. Le règne de Constantin naît grâce à
des conquêtes militaires et des crimes ; ce fut un régime totalitaire.
Cet Empereur sans scrupules sut tirer parti de la situation pour réunifier
l'Empire. Du pouvoir impérial, Constantin s'efforça d'en
faire une autorité absolue et de droit divin. Il l'environna de
toutes les splendeurs du costume, du diadème et de la pourpre,
de toutes les pompes de l'étiquette, de tout le faste de la cour
et du palais. Se tenant pour le représentant de Dieu sur la terre,
jugeant qu'en son intelligence il réflétait l'intelligence
suprême, il s'appliqua en toutes choses à marquer le caractère
sacré du souverain, à le séparer de l'humanité
par les formes solennelles dont il l'entoura, à faire, en un mot,
de la royauté terrestre comme une image de la royauté divine.
Pareillement, pour accroître le prestige et la force de l'institution
impériale, il voulut que la monarchie fût une monarchie administrative,
strictement hiérarchisée, exactement surveillée,
et où toute l'autorité serait concentrée entre les
mains de l'empereur. Enfin, en faisant du christianisme une religion d'État,
en multipliant en sa faveur les immunités et les privilèges,
en le défendant, contre l'hérésie, en le couvrant
en toutes circonstances de sa protection, Constantin donna un autre caractère
encore à l'autorité impériale. Siégeant parmi
les évêques, « comme s'il était l'un d'entre
eux », se posant en gardien attitré du dogme et de la discipline,
intervenant dans toutes les affaires de l'Église, légiférant
et jugeant pour elle, l'organisant et la dirigeant, convoquant et présidant
les conciles, dictant les formules de foi, Constantin - et après
lui tous ses successeurs, qu'ils fussent orthodoxes ou ariens - réglèrent
d'après un même principe les rapports de l'État et
de l'Église. Ce fut ce qu'on appellera le césaropapisme,
l'autorité despotique de l'empereur sur l'Église ; et le
clergé oriental, clergé de cour, ambitieux et mondain, docile
et souple, accepta sans protester cette tyrannie.
 Le pacte entre L'empereur
et les Pères de l'Église leur accordait des privilèges
afin d'obliger le reste des chrétiens à porter les armes,
servir dans l'armée, malgré eux. Ce despote est donc Grand
Pontife et intervient personnellement dans les débats et décisions conciliaires.
L'Église subit alors des modifications profondes et le christianisme
devient religion d'État.
Le pacte entre L'empereur
et les Pères de l'Église leur accordait des privilèges
afin d'obliger le reste des chrétiens à porter les armes,
servir dans l'armée, malgré eux. Ce despote est donc Grand
Pontife et intervient personnellement dans les débats et décisions conciliaires.
L'Église subit alors des modifications profondes et le christianisme
devient religion d'État.
 Ce césaropapisme
se poursuivit avec ses successeurs et, sous Theodose et Valens, toutes
les écoles satellites de la célèbre école
d'Alexandrie fermèrent, et les bibliothèques brûlèrent;
tous les autres courants du christianisme disparurent officiellement,
mais pas complètement : ils constitueront ce qu'on peut appeler
l'ésotérisme chrétien, car la part ésotérique
de la religion a été rejetée par l'Église,
alors que les moines tentent de la maintenir.
Ce césaropapisme
se poursuivit avec ses successeurs et, sous Theodose et Valens, toutes
les écoles satellites de la célèbre école
d'Alexandrie fermèrent, et les bibliothèques brûlèrent;
tous les autres courants du christianisme disparurent officiellement,
mais pas complètement : ils constitueront ce qu'on peut appeler
l'ésotérisme chrétien, car la part ésotérique
de la religion a été rejetée par l'Église,
alors que les moines tentent de la maintenir. ![]()
Emprunté au paganisme, le culte marial apparaît en ce lieu à la fin du IVe siècle: La grande Déesse, Artémis, Reine du Ciel, était encore vénérée. Avec leur commerce de statuettes, les Ephésiens vénéraient Diane de sorte que l'évêque d'Ephèse voulut décerner à Marie le même titre pour mettre à profit la déesse des chrétiens. Même chose avec d'autres réminiscences païennes, la question remonte toute la hiérarchie. C'est le concile d'Ephèse qui élabore le dogme du péché originel. Un nouveau schisme se profile à l'horizon (Latran) pour la proclamer toujours vierge ...jusqu'au concile de Trente.
Propositions de Wiclef
: Dans le rite de l'Eucharistie, la substance du pain et du vin demeure
et Jésus n'y est pas réellement présent ; On ne
voit pas dans L'Évangile que Jésus-Christ ait institué
la messe ; La confession est inutile à tout homme contrit ; Tout
prêtre ou évêque en péché mortel cesse
d'administrer validement ; Enfin, et c'est l'article fondamental, l'homme
est privé de son libre-arbitre, nécessairement, il se
perd ou il se sauve fatalement.![]()
